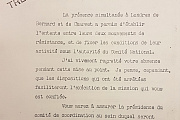JEAN MOULIN. Le livre "PREMIER COMBAT". Texte francais

Juin 1940. Chartres, submergée par la foule des réfugiés du Nord, s’est simultanément vidée de ses propres habitants. Quelques unités combattantes en retraite la traversent encore, bientôt suivies par les premiers détachements de la Wehrmacht. Resté à peu près seul à son poste, le jeune préfet est convoqué par le vainqueur, qui veut le contraindre à signer un document mensonger portant atteinte à l’honneur de l’armée française.
Le dramatique récit de Jean Moulin, dont le dépouillement fait la force, ouvre, le 17 juin 1940, le grand livre de la Résistance. Loin d’en ternir l’éclat, le temps écoulé lui confère aujourd’hui un relief et une signification que son auteur n’imaginait probablement pas.
LES ÉDITIONS DE MINUIT
JEAN MOULIN
PREMIER COMBAT
Préface du Général de Gaulle
LES ÉDITIONS DE MINUIT
© 1947 by LES ÉDITIONS DE MINUIT pour l'édition papier
© 2013 by LES ÉDITIONS DE MINUIT pour la présente édition électronique
ISBN 9782707326928
PREFACE
MAX, pur et bon compagnon de ceux qui n’avaient foi qu’en la France, a su mourir héroïquement pour elle.
Le rôle capital qu’il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même, mais ce n’est pas sans émotion qu’on lira le Journal que Jean Moulin écrivit à propos des événements qui l’amenèrent, dès 1940, à dire Non à l’ennemi.
La force de caractère, la clairvoyance et l’énergie qu’il montra en cette occasion ne se démentirent jamais.
Que son nom demeure vivant comme son œuvre demeure vivante!
Ch. DE GAULLE.
1er Juin 1946.
INTRODUCTION
Ce n’est pas sans émotion que je livre au public ces pages où mon frère a relaté les sombres journées de juin 40 à Chartres, et sa résistance héroïque aux brutes nazies.
Elles furent écrites à Montpellier, au printemps de 1941, pendant l’une de ses visites clandestines à sa famille. Ses souvenirs, qui remontaient à plusieurs mois, étaient demeurés étonnamment vivaces.
Je revois mon frère, penché sur ses feuillets, retraçant presque sans ratures et heure par heure les étapes de sa lutte et de son martyre.
Jusqu’alors je n’avais su que par des tiers, ou par des allusions fugitives, à quels sommets de patriotisme il s’était élevé aux jours néfastes de la ruée allemande.
Il n’aimait guère se vanter, et lui, si confiant à d’autres égards, il avait, en matière de sentiments, une réserve qui en imposait même à ses proches. On conçoit qu’il répugnât à évoquer le drame du 17 juin.
Son travail achevé, il me le donna à lire et m’en confia la garde. Nous fîmes peu de commentaires l’un et l’autre, mais nos pensées et nos cœurs étaient plus unis que jamais. Avant d’entreprendre, par ses seules ressources, son premier voyage à Londres, il avait voulu laisser ce témoignage de la mauvaise foi, de la barbarie et du sadisme allemands à verser ultérieurement au dossier de l’histoire. En le publiant, j’obéis à sa volonté.
On trouvera dans ces pages quelques appréciations qui paraîtront sévères. Il faut se replacer dans l’ambiance de juin 1940, dans l’état d’esprit d’un patriote qui accomplissait des efforts surhumains pour s’opposer à la débâcle, d’un chef prêt à se faire tuer à son poste et qui n’admettait pas les défaillances. S’il avait vécu, il aurait pu réviser certains de ces jugements. On ne saurait en faire état pour jeter la pierre à quiconque.
Il songea un moment à emporter ce journal à Londres, mais cela eût risqué de compromettre un voyage dont l’enjeu était capital pour l’avenir de la Résistance.
J’emportai le manuscrit en Provence, ainsi que d’autres papiers compromettants, à « La Lèque », mas perdu dans les Alpilles dont le site était cher à mon frère. C’est là qu’à son premier retour de Londres, le 31 décembre 1941, il devait se faire parachuter.
Après la Libération, j’allai exhumer les papiers. A part la rouille des agrafes et quelques moisissures et bavures, les pages étaient intactes.
Pourquoi ai-je tant tardé à faire paraître ce journal ? C’est que, dans le doute qui, même après la Libération, planait sur le sort réel de Max 1, mon but principal fut de percer le mystère de sa disparition.
Maintenant que le doute, hélas ! est dissipé, l’heure est venue de révéler à la France le premier combat du futur chef de la Résistance.
Quand les S.S. ou autres forcenés, dans l’ivresse de leur avance, vinrent l’arrêter à la Préfecture de Chartres, le 17 juin au soir, Jean Moulin n’était qu’un préfet resté à son poste au milieu de la désertion générale, un fonctionnaire accomplissant son devoir envers et contre tout. Le miracle qui le sauva alors ne pourra se reproduire.
Trois ans passèrent de vie dangereuse, de travail intense, de veilles, d’inconfort, de déplacements incessants, de prouesses physiques, de négociations délicates, d’organisation solide et intelligente avec, pour couronnement, la fondation du Conseil National de la Résistance et sa première réunion à Paris le 27 mai 1943. Moins d’un mois après, le 21 juin, à Lyon, sur dénonciation d’un traître, il tombait à nouveau aux mains des nazis. Mais cette fois, il n’était plus un préfet anonyme, c’était Max, l’ennemi le plus redoutable des Boches, celui qui, derrière le Général de Gaulle, avait soudé et dressé toutes les forces vives de la Nation.
Certes, en 1940, à Chartres, la cruauté allemande était à son comble, mais la torture, si inhumaine et raffinée fût-elle, était encore improvisée et non techniquement installée avec ses chambres infernales et ses dosages savants.
Quel fut le calvaire de Max, en 1943, dans les antres de la Gestapo, le saura-t-on jamais, alors que, portant en lui tous les secrets de la Résistance, fidèle à l’amitié, fanatique de l’honneur, il endura, dans sa chair et son âme saignantes, des heures, des jours et des nuits, une éternité de souffrance faisant front contre l’ennemi jusqu’à l’agonie, jusqu’à la mort !
Toi qui, même au milieu de ta course, respirais la jeunesse et la vie, toi qui fus le plus jeune préfet de France, toi qui étais la fierté de ton père et le sourire de ta mère, toi qui joignais la gentillesse à la force d’âme et qui réalisais cette gageure d’être un artiste né et un homme d’action, d’aimer passionnément la vie et de ne pas craindre la mort, puisse ton sacrifice n’avoir pas été vain ! Que ce pays de liberté et de justice sache qu’il est urgent que le sens du devoir civique l’emporte sur l’esprit de parti et que les Français entendent la voix de Jean Moulin leur crier encore : « Messieurs, il y a la France ! »
Laure MOULIN.
1. Dernier nom de Résistance de Jean Moulin.
JOURNAL
(CHARTRES 14-18 JUIN 1940)
COUP de téléphone du Colonel du Tillet, commandant la subdivision, qui m’apprend que les Allemands ont atteint la Blaise et que le grand Etat-Major a décidé un vaste mouvement de repli jusqu’à la Loire. Il s’étonne que je sois encore là et que je n’aie point fait évacuer ce qui reste des services civils administratifs.
Je lui fais connaître que mes intentions sont de conserver le plus longtemps possible les organismes civils qui sont encore auprès de moi.
4 heures 30.
J’ai réuni les chefs de service dans la salle du Conseil Général. Tout en me gardant de dévoiler les intentions du G.Q.G., je ne leur cache pas que la situation s’aggrave. Je compte, jusqu’à nouvel ordre, les conserver à ma disposition quel que soit le risque à courir. Je trouve dans leurs réactions un excellent état d’esprit.
5 heures.
Ordre du Gouvernement d’avoir à replier d’urgence tous les « affectés spéciaux ». Ce seront les dernières instructions que je recevrai du pouvoir central.
C’est une décision grave, qui va vider de leur substance les organismes administratifs, économiques et sociaux. Tous les postes essentiels ou presque, sont occupés par des affectés spéciaux, l’affectation spéciale s’appliquant à des hommes en âge d’être mobilisés mais dont le maintien à leur poste est jugé indispensable. Mon secrétaire général, mes deux sous-préfets et moi sommes affectés spéciaux.
Je sais, au surplus, que cet ordre aura pour effet secondaire de précipiter dans la fuite les derniers civils.
Mais le Gouvernement a certainement ses raisons et notamment le désir de soustraire à l’emprise ennemie le plus grand nombre possible d’hommes qualifiés susceptibles de poursuivre leur tâche derrière la ligne de résistance. D’ailleurs, pour les modalités d’application, impossible de consulter le ministère. J’ignore désormais où il se trouve et, depuis cette nuit, je ne peux plus avoir de communication téléphonique au-delà de Châteaudun.
Enfin, dans une des dernières émissions qu’il nous a été donné d’entendre avant l’interruption totale du courant électrique, la radio a annoncé la nouvelle.
J’essaie d’atténuer la rigueur du texte qui ne comporte pas d’exception, en demandant aux maires que je peux joindre de maintenir auprès d’eux les hommes qu’ils jugeront indispensables au fonctionnement des services vitaux de la commune et des services de guerre. Malgré ces instructions – contraires, il est vrai, à la lettre de la décision gouvernementale telle qu’elle m’a été notifiée – tous ou presque tous les affectés spéciaux autres que ceux qui dépendaient directement de mon autorité (personnel de la Préfecture, chefs des services administratifs, commissaires de police) partirent en quelques heures, à l’aube de cette journée du 14 juin.
Ainsi fut mise à son comble la panique déjà considérable créée dans le département par les bombardements et le passage de centaines de milliers de réfugiés.
Et, dès ce matin, le bombardement de Chartres a repris, plus intense et plus meurtrier que la veille.
Depuis quelques jours, le réseau des « mailles » de transmission aérienne ayant été disloqué du fait du repli de notre aviation, les raids ennemis n’étaient plus annoncés dans le département que par les guetteurs locaux. C’est dire que, le plus souvent, les bombes tombaient avant la mise en marche des sirènes. Aujourd’hui, il n’y a même plus de sirènes, les guetteurs militaires étant partis à leur tour. Les quartiers du terrain d’aviation, de la Poste, de l’Hôpital et de la Gare, toutes les voies conduisant vers le sud et l’ouest, et notamment la rue du Grand-Faubourg, sont gravement atteints. Derrière la Poste, l’hôtel du « Bœuf Couronné » et tout le pâté de maisons avoisinantes brûlent sous l’effet des bombes incendiaires.
Nous n’avons plus maintenant ni gaz, ni électricité, ni téléphone, ni radio. J’assiste aux opérations de secours. Les équipes, hélas ! se réduisent de plus en plus. Mais les braves qui restent semblent d’autant plus dévoués et courageux qu’ils sont moins nombreux.
Où sont les cadres de la Défense passive ? Le directeur municipal de D.P. a fui cette nuit avec plusieurs de ses collaborateurs.
Où sont les pompiers et leur matériel ? Le maire les a laissés partir ce matin, avec les pompes, sous la conduite du capitaine et du secrétaire général de la mairie, juchés sur la grande pompe.
Parti aussi le directeur du service des eaux de la ville. Dans sa folle panique, avant de fuir, il a congédié les mécaniciens de l’usine hydraulique et bloqué les vannes, si bien que, dans quelques heures, la ville va être privée d’eau.
J’avais pourtant demandé moi-même, cette nuit, au maire de Chartres, par téléphone, de conserver les affectés spéciaux de tous les services municipaux essentiels, et notamment de la Défense passive et du service des sapeurs-pompiers.
11 heures.
Avec un jeune lieutenant d’artillerie qui est resté pour diriger le parc à essence, je m’occupe de la répartition de l’essence aux réfugiés qui affluent toujours. J’obtiens de lui que les attributions de carburant se fassent désormais gratuitement et que des dépôts supplémentaires soient créés sur le trajet Chartres-Châteaudun et Chartres-Nogent-le-Rotrou. Il faut déblayer le plus possible pour faciliter la manœuvre de nos troupes.
15 heures 30.
Paris est pris! La nouvelle nous est apportée par les réfugiés. Pour notre secteur, je n’ai aucune précision sur l’avance allemande depuis la communication du Colonel commandant la subdivision. Le téléphone est coupé depuis plusieurs jours avec Dreux et le service d’estafettes de gendarmerie que j’avais organisé pour y suppléer a été interrompu hier soir sur ordre du commandant, en raison de la violence des bombardements.
Je sais, par les messages qui m’ont été apportés hier, qu’il ne reste plus de civils à Dreux et que les dernières collectivités qui devaient être évacuées l’ont été en temps utile. Pour cette région du département, la première touchée, j’ai pu fournir les véhicules et le personnel nécessaires.
Mais je suis inquiet pour le maire et le sous-préfet qui ont pour mission de rester jusqu’au dernier moment. Ils ont besoin d’instructions et je voudrais aussi leur apporter un réconfort moral. Ici, les gens, privés de nouvelles, se laissent aller aux pires suppositions. Déjà le bruit court en ville que les Allemands sont parvenus à Dreux. J’ai besoin de savoir, ne fût-ce que pour démentir.
Je décide d’aller à Dreux. J’obtiens difficilement un gendarme pour m’accompagner, le commandant estimant la mission périlleuse et l’ordre de départ de la compagnie étant donné pour le soir même.
Je prends le volant. Nous sommes bombardés et mitraillés tout le long du chemin par des vagues d’avions venant du Nord et volant entre 200 et 50 mètres. Sur cette route où, hier encore, se pressaient des milliers de réfugiés, personne, à part quelques soldats harassés qui fuient sans rien savoir…
Après plusieurs stations sous les arbres le long de la route, nous arrivons enfin à Dreux. Je trouve le maire, M. Viollette, et le sous-préfet, M. Ressier, à la mairie.
Le dépôt du régiment colonial vient, m’annoncent-ils, de quitter la ville, mais le colonel doit être encore là. Nous allons le saluer. Nous le trouvons au quartier en train de faire ses derniers préparatifs de départ.
Je lui demande des nouvelles. Dans notre région, la manœuvre de repli semble s’effectuer dans les conditions prévues, et il ne pense pas que les Allemands aient déjà franchi les limites du département. Il me dit ses regrets de n’avoir pu obtenir l’autorisation de défendre Dreux. J’assiste à son départ.
Ensuite, avec le sous-préfet et le maire, nous faisons un tour en ville. C’est la solitude et ce serait le silence, si le ronron sinistre des avions allemands ne se faisait entendre sans arrêt.
Dans la voiture qui nous emmène tristement, personne ne dit mot, mais chacun de nous a les mêmes pensées. Ainsi, c’est fini ! Les Boches vont entrer dans le département sans que leur soit opposée d’autre défense que celle de quelques éléments en contact qui se replient.
Je regarde Viollette, assis à mes côtés. C’est sa ville qui, demain, dans quelques heures peut-être, va être livrée à l’ennemi ; c’est cette ville qu’avec une poigne parfois un peu rude, il a dirigée pendant trente ans. Il n’est pas de quartier, pas de rue, pas un coin de terre qui ne lui doive quelque chose.
Ses adversaires disaient de lui « qu’il avait la maladie de la pierre ». Et c’est vrai. Il a bâti, bâti sans arrêt, des hôpitaux, des maternités, des écoles, des sanas, des cités ouvrières…
Maintenant que nous roulons dans ces rues semées de ruines, face à cette œuvre de destruction systématique, je pense qu’il est beau d’être accablé du nom de bâtisseur.
Après m’être assuré que toutes les mesures que j’avais ordonnées ont été prises et avoir donné au sous-préfet, qui est affecté spécial, les instructions nécessaires à son départ, je quitte Dreux.
Une heure après, les motocyclistes ennemis y faisaient leur apparition.
Le retour à Chartres nous ménage une vision saisissante. Un gigantesque panache de fumée s’élève à des milliers de mètres dans le ciel et semble tisser un immense voile de deuil sur la cathédrale.
C’est le dépôt d’essence de la base aérienne qui a explosé et qui se consume lentement.
Il est dix-neuf heures environ. Dans la cour de la Préfecture, j’ai la désagréable surprise de voir tout mon personnel entassé dans des camions et prêt au départ. J’avais donné des ordres formels pour que chacun restât à son poste.
Furieux, je somme mes gens de descendre et j’enjoins à chacun de reprendre son poste, jusqu’à nouvel ordre.
Je ne reconnais plus mon personnel. Quelques femmes sont dans un état effroyable. Des hommes qui, hier encore, refusaient de descendre dans les caves pendant le bombardement pour travailler à mes côtés, sont saisis par la peur. Tel ancien combattant de 14, réputé courageux, qui, il y a quelques heures à peine, était volontaire pour une mission dangereuse, a complètement perdu le contrôle de lui-même.
Le vent de panique qui les avait jusqu’ici épargnés a maintenant soufflé sur eux. Les nerfs sont à bout. Chacun n’a qu’un but : Fuir.
Je les exhorte, je les adjure. Ils obéissent et retrouvent un certain automatisme professionnel, mais je sens bien qu’à quelques exceptions près, dont mon chef de cabinet et mon huissier personnel, je ne peux plus compter sur eux.
Mes antichambres sont combles. Les chefs de service qui ne sont pas déjà partis sur ordre de leur administration restent ici en permanence, prêts à prendre la route. La Préfecture semble être l’ultime refuge.
Au milieu des paquets d’archives et de valises, je distingue dans la pénombre l’évêque de Chartres, Mgr Harscouët, qui vient s’excuser de ne pouvoir rester – une ordination de prêtres l’appelant dans le sud du département – et le sénateur-maire de Chartres, M. Gilbert, qui vient également m’annoncer son départ. Il est là avec sa femme et ses bagages. Les événements tragiques de ces jours derniers, pendant lesquels il s’est fortement dépensé, l’ont visiblement épuisé. Par surcroît, il y a quelques heures, il a perdu sa belle-sœur et sa nièce dans le bombardement. J’aperçois aussi quelques fantoches familiers, tel le commissaire spécial, un peu ivre d’avoir trop précipitamment vidé sa cave. Cet homme, discret à l’accoutumée, parle fort et distribue des cigarettes anglaises. Je le rappelle à un peu de tenue.
21 heures.
L’heure avance et je n’ai pas d’autre nouvelle que celle de l’apparition d’une patrouille allemande à Dreux qui m’est rapportée par Viollette et Ressier, qui viennent d’arriver. Rien, non plus, sur la situation générale, car nous sommes désormais sans communication avec l’extérieur.
Je convoque le capitaine Bertrand, naguère chef du service des informations, que j’ai demandé comme agent de liaison avec la subdivision. Il n’a pu obtenir aucun renseignement.
Je sens qu’on s’énerve de plus en plus autour de moi et qu’on est obsédé par ces trente-cinq kilomètres qui séparent Chartres de Dreux.
J’ai tenu jusqu’à présent mes collaborateurs, mais de nouvelles décisions vont s’imposer avec le déroulement des événements. J’irai avec Bertrand interroger le commandant Bourgeois, commandant du dépôt du… R.I., qui a installé son P.C. au château de…, à Courville.
Je reprends la Citroën. En pleine nuit, sans phares, nous nous dirigeons sur Courville. Plus de bombes, mais des camions et des voitures de réfugiés qui manquent à tout instant de nous télescoper, tant les conducteurs sont « choqués » par les bombardements qu’ils ont subis, et tant ils ont hâte d’avancer vers l’ouest…
Nous trouvons le commandant Bourgeois travaillant aux chandelles dans le grand salon du château.
Il me met rapidement au fait : « J’ai reçu, me dit-il, l’ordre de me porter, à l’aube, sur la route de Dreux à Chartres par Châteauneuf pour retarder l’avance allemande. Je dois essayer de faire jonction avec les débris d’une division coloniale dont on n’a aucune nouvelle. Je dispose d’environ huit cents hommes, des récupérés ou des hommes de deuxième réserve… Je n’ai qu’une vingtaine de mitrailleuses ! La question sera promptement réglée, hélas !… Or des éclaireurs ennemis sont venus ce soir reconnaître Dreux. Demain matin, à la première heure, les troupes motorisées vont occuper la ville et continuer leur marche sur Chartres. Aucun obstacle sur leur route sinon mes faibles forces et les hypothétiques effectifs coloniaux. A mon avis, les Allemands peuvent être à Chartres dès le début de l’après-midi. »
Après avoir remercié le commandant Bourgeois et lui avoir exprimé mes vœux pour lui et ses hommes, nous prenons le chemin du retour.
Chartres est toujours embrasée. Dans la rue du Grand-Faubourg, les pans de murs épargnés par le bombardement ont un aspect plus tragique encore avec la nuit, sous l’éclairage blafard de l’incendie.
Decote, mon chef de cabinet, m’annonce que les gendarmes viennent de quitter Chartres. Ainsi, les derniers militaires ont évacué la ville. La base aérienne s’est repliée il y a trois jours. La garnison est partie hier. Partie aussi l’Intendance, l’Intendance qui doit assurer le ravitaillement de la population civile !… Et nous avons des milliers de réfugiés à nourrir ! Seuls sont encore là l’état-major de la subdivision et son chef, le commandant du Tillet, qui partent demain à la première heure.
En présence des indications très nettes du commandant Bourgeois sur le processus des opérations, je décide de profiter de la nuit pour évacuer le personnel de la Préfecture sur le sud du département (à Cloyes, à 50 kilomètres de Chartres), sous les ordres du secrétaire général qui devra, selon les événements, poursuivre la route ou ramener le convoi.
Même décision en ce qui concerne les chefs de service qui demeurent encore auprès de moi. La lutte continue, ils seront plus utiles de l’autre côté. Je les remercie du concours qu’ils m’ont apporté dans ces heures difficiles.
15 juin, 2 heures du matin.
Je fais deux lettres que je confie au secrétaire général, l’une pour le ministre de l’Intérieur, l’autre pour ma mère.
La lettre à Mandel n’arrivera pas. J’annonçais au ministre que, ainsi que je le lui avais déclaré, je restais à mon poste et que je ne faillirais pas à mon devoir.
Je lui signalais aussi la belle attitude de certains de mes administrés et de quelques-uns de mes collaborateurs.
Decote, mon chef de cabinet, et Edouard, mon huissier, partent à leur tour, bien à contrecœur et sur mon ordre formel.
8 heures.
Je fais ce matin le bilan de la situation. Il est désastreux. Plus aucune organisation économique ni administrative. Tout un édifice social à reconstruire dans des conditions matérielles effroyables, sous les bombardements, alors qu’un quartier de la ville est en flammes, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans téléphone…
Mais il le faut pour tous ceux dont le sort est entre nos mains ; il le faut, pour opposer aux Allemands, lors de leur arrivée, une armature sociale et morale digne de notre pays.
Je n’ai pas de peine à faire admettre ces sentiments à la poignée de Chartrains, des vieux, pour la plupart, qui m’ont offert leurs services. (Il ne reste plus que sept cents à huit cents habitants sur vingt-trois mille que comptait la ville.)
Quel réconfort, après le spectacle des défaillances de ces jours derniers, de voir ces hommes et ces femmes, venus de tous les horizons politiques et sociaux, communier avec ardeur dans la même foi et prêts à réaliser une entreprise de solidarité humaine à peu près sans exemple.
Je répartis les tâches, je dicte les consignes : tel qui, hier, était rédacteur de journal, est chargé de me seconder dans la répartition des vivres ; un de ses confrères, du journal concurrent, se consacrera à la police et dirigera la petite équipe de volontaires que nous avons constituée. Un professeur d’école religieuse a mission de faire enterrer les morts, nombreux, hélas ! qui sont entassés dans la morgue de l’hôpital et à l’hospice Saint-Brice (quarante-neuf ont été ainsi ensevelis dans la cour de l’hôpital, treize à Saint-Brice et trente-quatre au cimetière) ; tel dirigera les corvées d’eau destinées à assurer, depuis la basse ville, l’alimentation des centres de secours, des établissements publics, des boulangeries ; tel autre organisera la récupération du bétail abandonné et constituera des parcs de rassemblement ; tels autres, enfin, s’occuperont de la voirie, de la salubrité, de la lutte contre l’incendie, de l’hébergement des réfugiés, des soins à donner aux blessés et aux malades.
A l’hôpital civil, la sœur supérieure étant partie, c’est sœur Henriette qui la remplacera. Elle sera admirable de dévouement simple et de générosité. Elle aura, à ses côtés, l’économe, M. Fleury, demeuré à son poste.
Je sais que je peux compter sur le docteur Foubert, dentiste militaire, qui, bien que marié et père de famille, a demandé à rester comme volontaire au moment du départ du service de santé. Il gardera, dans les pires instants, une attitude calme et courageuse.
Le service de santé militaire a quitté Chartres le 14 après-midi, évacuant trente camions sanitaires contenant des blessés et le personnel médical et infirmier. Les opérations d’embarquement se déroulèrent sous le bombardement, et le chef du service de santé de Chartres, le médecin-colonel de Fourmestreaux, fut blessé légèrement à la tête.
Le convoi, qui se dirigeait sur Vannes, sous les ordres du docteur de Fourmestreaux, emmenait avec lui le médecin-commandant Baudin, médecin-chef de l’hôpital civil, qui, cependant, avait demandé à rester à son poste. Le docteur de Fourmestreaux préféra conserver le docteur Baudin auprès de lui et laisser à Chartres le médecin-capitaine Foubert, également volontaire.
Enfin, Chartres a les sœurs de Saint-Paul qui s’élèveront, en ces heures tragiques, à la hauteur de leurs plus belles traditions d’héroïsme et de bonté. Animées par la foi de Mgr Lejards, qui est partout où il y a du danger, partout où il y a de la peine, elles seront les bons anges de notre misère.
.........................
Le problème le plus angoissant est celui du ravitaillement. L’unique conseiller municipal qui soit resté à Chartres, M. Besnard, me confirme que les deux derniers boulangers de la ville sont partis hier soir. Il ne reste plus, d’ailleurs, un seul commerçant à Chartres. J’ai fait l’impossible pour enrayer le mouvement de fuite : exhortations, réquisitions, sanctions, tout a été vain.
Tout être humain possédant un véhicule à quatre ou à deux roues a fui depuis longtemps. L’immense exode des piétons a suivi.
.........................
Mais si Chartres est à peu près vidée de ses habitants, le flot monstrueux de la région parisienne se déverse toujours aussi dense sur la ville.
Combien sont-ils ces Parisiens, ces banlieusards qui ont déferlé sur l’Eure-et-Loir ? Un million ? Un million cinq cent mille ?
Certes, ils ont déjà subi le terrible choc moral de la guerre. Ils n’en ont pas, pour la plupart, connu vraiment les horreurs matérielles : les bombardements en piqué, les rafales de mitrailleuses qui prennent les convois de réfugiés en enfilade… Ils n’ont pas connu tout cela, tout ce que vous connaissez, depuis des semaines, Belges, Ardennais, gens du Nord, Picards !…
Demain ils auront aussi leur tragique aventure. A Chartres même, certains vont payer leur tribut. Mais, pour l’instant, les Parisiens ne clament que leur faim.
J’ai heureusement pris des précautions. Ces jours derniers, en dépit de la carence de l’Intendance qui, avant son départ, n’a pu me fournir ni vivres ni pain, j’ai fait réquisitionner dans le commerce et stocker dans les garages de la Préfecture trois tonnes environ de conserves1. J’ai, d’autre part, reçu de Blois, grâce à l’obligeance de mon collègue du Loir-et-Cher, deux autocars chargés de pain. J’en avais demandé huit qui, au retour, auraient assuré le transport des blessés et des malades. Deux seulement ont pu me parvenir. Cela représente environ 800 kilos de pain. C’est peu.
Il s’agit maintenant de tenir jusqu’à ce que nous ayons pu faire fonctionner quelques boulangeries.
J’aurai l’agréable surprise, à midi, de recevoir la visite d’un vieil ouvrier boulanger de la rue Muret, le seul qui soit demeuré à Chartres. Sa patronne est partie et il vient déposer sur mon bureau, soigneusement pliée dans son mouchoir, la recette de la matinée. Il se met à ma disposition pour continuer sa besogne, à condition qu’on l’autorise à puiser dans le stock de farine de sa patronne. Non seulement j’acquiesce, mais je lui procure deux volontaires pour l’aider à pétrir, car il me faut du pain, beaucoup de pain…
13 h 30.
Sur deux gros camions qui devaient rejoindre les usines Renault à Paris et que j’arrête au passage, je charge une centaine d’orphelins de l’asile d’Aligre qu’on m’a supplié d’évacuer sur Limoges. A peine sont-ils partis que le bombardement reprend violemment. Ils ont quitté la ville à temps !
15 heures.
Tournée en auto pour mon information. Je descends vers le bas de la ville par les petites rues du quartier de la Cathédrale. Portes et volets clos. Je n’ose pas écrire que tout est calme, tant ce mot est choquant dans cette atmosphère de désolation.
En approchant des boulevards, la vie reparaît. Triste vie ! C’est toujours le long cortège des réfugiés qui se déroule. Mais le flot est moins dense et surtout beaucoup plus lent. Il y a deux jours encore, c’était le moteur qui entraînait cette masse humaine. Aujourd’hui, il semble que ce soient les grands chars des paysans qui donnent le rythme, ces chars dont beaucoup traînent après eux de lourdes autos désormais silencieuses. Les cyclistes et les piétons dominent, fourbus sous leur charge. Dans la masse, de nombreux soldats qu’aucune autorité militaire ne regroupe.
Place des Epars, le défilé se poursuit lamentablement entre deux haies de suppliants. Autour de la statue de Marceau et sur tous les trottoirs qui entourent la place, des milliers de gens tendent désespérément les bras vers des véhicules pleins à craquer qui ne s’arrêteront pas pour les prendre.
L’apparition d’un homme seul sur une voiture qui marche fait exploser les convoitises. Après m’avoir sollicité à distance, des dizaines d’êtres humains courent s’accrocher, en grappes, à ma Citroën.
J’ai toutes les peines du monde à avancer. Malgré toutes mes explications sur mes fonctions, sur l’obligation morale que j’ai de rester, ils m’implorent de les emmener n’importe où, vers le sud ou vers l’ouest, loin de cette ville de misère et de mort, loin de l’envahisseur qui approche. Une vieille dame me poursuit de ses supplications en répétant : « Je vous paierai, Monsieur. » Et, pour que je n’aie aucun doute à cet égard, elle me tend désespérément une poignée de billets…
Je me dégage non sans difficulté et je m’empresse d’aller remiser ma voiture, bien décidé à ne pas la montrer pour l’instant ; c’est trop cruel.
A la Préfecture, beaucoup de monde. On m’attend pour recevoir les vivres et le pain destinés aux collectivités et aux centres d’accueil. Après avoir fait une distribution, je reviens place des Epars retrouver les malheureux que j’y ai laissés.
Les deux pôles d’attraction sont les deux grands hôtels de Chartres, l’hôtel du Grand Monarque et l’hôtel de France, qui se font face sur la vaste place circulaire.
Les propriétaires et les employés sont partis, mais les clients sont restés. Pour la plupart d’entre eux, ce fut l’aventure banale et renouvelée à l’infini : l’auto en panne, abandonnée quelque part au bord de la route ; la ville la plus proche gagnée à pied avec ce qu’on a pu sauver de bagages ; et ici, à l’hôtel, l’attente d’un chimérique secours…
A ces premiers occupants sont venus s’agglomérer tout ce que la route a rejeté d’épaves.
Il y a du monde partout, dans les chambres, dans les salons, sur les marches d’escalier. Des gens mangent sur des tables où s’entassent les reliefs des convives précédents. L’argenterie traîne sur les meubles. Dans les coins, des matelas recueillent des familles entières, harassées. Ceux qui n’ont pu avoir accès à l’intérieur se sont installés dehors, sur des chaises et des fauteuils de la maison, à côté de leurs bagages. Toutes les classes, tous les âges, tous les sexes sont mêlés dans une promiscuité tragique.
Dès mon arrivée, on m’entoure. Je m’efforce de calmer les angoisses de ces malheureux, tout en ne leur laissant pas ignorer qu’il ne peut être question de les faire transporter plus loin. Le dernier train est parti hier soir et je ne dispose plus d’un seul autocar ou d’un seul camion. J’essaie de leur faire comprendre qu’il faut se résigner à rester. Certes, il y aura des difficultés de ravitaillement, mais je m’efforcerai d’y remédier. Il ne faut pas, en tout cas, se lancer à nouveau sur la route, à pied, avec des vieillards, des enfants, des bagages. Nous avons des centres d’accueil, nous en créerons d’autres, au besoin, les locaux vides ne manquent pas, hélas ! Mais les bombardements ? les Allemands ? Nous avons d’excellents abris et les Allemands ne s’attaquent généralement aux réfugiés que du haut de leurs avions pour les faire fuir. Il ne faut pas favoriser leurs desseins. Trop de réfugiés ont encombré les routes, gêné nos soldats, fait perdre des batailles. Il faut se résigner à rester. Je répète mon discours de groupe en groupe, un discours que j’ai déjà tenu bien des fois… Mais j’ai vite l’impression que je joue les prédicateurs dans le désert.
On continue à faire signe aux autos, aux charrettes, à tous les véhicules qui passent. Parfois on parvient à attendrir un conducteur, à se caser péniblement en surcharge ; ou bien, après avoir attendu longtemps, on prend la décision folle de repartir à pied…
Et il arrive toujours de nouveaux réfugiés pour remplacer ceux qui partent : c’est une ronde sans fin !
J’assiste à des scènes pénibles. Une femme, sur le seuil du « Grand Monarque », m’expose son cas. Elle est venue de Paris à pied avec une dame qui a partagé ses tribulations et en qui elle avait mis toute sa confiance. Or cette dame vient de la quitter brusquement en lui volant 6 000 francs, toute sa fortune. Je lui donne quelque chose. Elle pleure et me demande la permission de m’embrasser.
Il y a cent, mille autres cas plus tristes. Des enfants perdus, des femmes à la recherche de leur mari. Un fils, une fille qui devaient rejoindre une mère et qu’on attend vainement.
Beaucoup de drames s’inscrivent en graffiti naïfs sur les murs : « Nous sommes partis. Rendez-vous à Orléans », ou : « Avons perdu Robert. Allons à Poitiers… », et bien d’autres.
Je m’emploie de mon mieux à soulager toutes ces misères. J’ai la chance de trouver des concours parmi les réfugiés, parmi ceux, du moins, qui ont compris l’inanité de la fuite.
Il faut régler la question des hôtels. Au « Grand Monarque », parmi les « clients », se trouve un ancien consul de France qui accepte, sur ma demande, de prendre la direction de ce centre d’accueil improvisé et qui, au cours de ces journées tragiques, sera pour moi un collaborateur infiniment précieux.
Il aura tôt fait, avec sa femme, de mettre un peu d’ordre dans cette cour des miracles et d’organiser le ravitaillement à l’aide des vivres de la Préfecture.
A l’Hôtel de France, alors que je croyais tout le personnel parti – l’état d’abandon de la maison justifiant au surplus cette créance – un homme prétend être le gérant et avoir reçu mission du propriétaire de continuer l’exploitation de l’hôtel. Les patrons, que j’ai vus au moment de leur départ, ne m’ont pas prévenu, mais, après tout, c’est possible. L’essentiel est que tout le monde mange et dorme.
(J’apprendrai plus tard que ce prétendu gérant était un vulgaire imposteur qui liquida à son profit une grande partie de la cave de la maison. Pour éviter toute complication et mener l’affaire rondement, il avait institué un prix unique : 20 francs ! Les bouteilles défilaient sur le comptoir à un rythme inouï : 20 francs la fine Napoléon, 20 francs le whisky, 20 francs le Clos Vougeot, 20 francs le Pernod !… Après avoir travaillé pendant quelques mois au service des Allemands, ce qui lui assura une impunité provisoire, il put finalement être livré à la justice française.)
16 h 30.
N’ayant plus aucun moyen d’information, j’interroge réfugiés et soldats pour savoir où en est l’avance allemande. Contrairement à ce que pensait le commandant Bourgeois, l’ennemi a poussé furieusement vers l’ouest, remettant à plus tard l’occupation des points situés au sud de leur trajectoire directe. C’est ainsi que les troupes qui ont occupé Dreux ont dû poursuivre leur route sur Verneuil et Laigle, en direction d’Argentan.
Il semble que l’attaque de Chartres soit réservée aux colonnes venant de la région parisienne et avançant sur Rambouillet et Maintenon, ce qui nous laisserait un certain répit.
17 heures.
Je retourne chez moi pour constater que mon portail d’entrée a été enfoncé et que ma Citroën a disparu de la cour où je l’avais laissée une heure avant.
Deux vieillards de l’Hospice, venus chercher du pain et des vivres à la Préfecture pour leur établissement, me racontent comment ils ont assisté, impuissants, à l’effraction des grilles et au vol de ma voiture : « Ce sont, me disent-ils, des militaires français qui ont fait le coup. Ils se sont enfuis il y a un quart d’heure à peine. »
Je ne sais ce qui l’emporte chez moi, du dépit d’être privé de ma voiture en un moment aussi critique ou de la tristesse de voir dans quel état sont tombés certains éléments de l’armée française !
J’ai entendu si souvent, il est vrai, des soldats prétendre que leurs officiers avaient pris la fuite les premiers en se ruant sur les autos, que j’en arrive à trouver une excuse aux malheureux qui m’ont dépouillé.
Mais ce qui est inadmissible et inexplicable, c’est qu’aucune prévôté ne soit encore venue remplacer la gendarmerie, repliée depuis vingt-quatre heures, sur l’ordre de l’autorité militaire. Tous ceux qui, autour de moi, ont fait la guerre de 14 se souviennent du zèle manifesté par les gendarmes aux armées. Ont-ils pu nous empoisonner, bon Dieu, ces gendarmes à l’arrière du front ! Et aujourd’hui que nous en aurions réellement besoin, c’est en vain que nous les attendons ! Nous n’en verrons, du reste, pas un seul pendant les trois jours qui suivront le départ de la compagnie de Chartres et qui précéderont l’arrivée des Allemands.
Il y a vraiment, dans cette guerre, bien des mystères !…
17 h 30.
Comme pour aggraver mon ressentiment à l’égard de la maréchaussée, les quelques volontaires que j’ai chargés de la police viennent m’annoncer que plusieurs faits de pillage ont été constatés.
Notre maigre police a besoin d’être renforcée. Je convoque M. Besnard. Je lui demande d’essayer de trouver de nouveaux volontaires parmi les Chartrains valides. Mais en reste-t-il encore ? Nous en doutons. En attendant, je ferai une tournée en ville avec deux hommes pour me rendre compte et tâcher d’intimider un peu les pillards.
Au cours de cette tournée, nous observons qu’un certain nombre de boutiques, surtout des magasins d’alimentation, ont été forcées et que les portes et les vitrines laissées béantes offrent une tentation permanente aux passants. Je donne des instructions pour que toutes ces ouvertures soient refermées, au besoin à l’aide de planches clouées.
En rentrant à la Préfecture, on me rend compte des recherches que j’ai fait faire pour trouver deux autres boulangers. Parmi les Chartrains qui n’ont pas fui, il n’y en a aucun, en dehors du vieil ouvrier de la rue Muret, qui continue d’ailleurs vaillamment sa tâche. Parmi les réfugiés, toutefois, deux personnes se sont offertes : un Parisien, qui dit avoir tenu autrefois une boulangerie, et une paysanne qui a fait, dans le temps, son pain à la ferme.
Je décide aussitôt d’ouvrir deux boulangeries : rue du Soleil d’Or et rue du Pont-Saint-Hilaire. Pour donner à cette opération les apparences de la légalité, j’assiste avec M. Besnard, à l’effraction des portes des deux boutiques. Nous avons la chance d’y trouver une quantité appréciable de farine, ainsi que du sel. J’ai, d’autre part, à la Préfecture, un stock de levure, une des rares choses que j’aie pu obtenir de l’Intendance ! Les équipes chargées de la corvée d’eau assureront le ravitaillement des pétrins (nous avons, d’ailleurs, découvert une source dans une des cryptes de la cathédrale, toute proche) et, dans les centres d’accueil voisins, nous trouvons plusieurs volontaires qui se relaieront pour pétrir à la main. Dès ce soir nous aurons une fournée dans chaque établissement.
Le stock de pain de la Préfecture s’épuise et il est temps que nous assurions une production régulière. Enfin, je vais avoir trois boulangeries en fonctionnement !
19 heures.
Je viens d’apprendre qu’un ancien maire de Chartres, M. Vidon, est resté dans la ville. Je vais aussitôt à son domicile. Je sais que c’est un homme énergique, capable de rendre de grands services.
Je lui explique ce que j’attends de lui, aux côtés de M. Besnard, pour toutes les questions intéressant la ville et notamment les travaux communaux. Il faut, avant tout, essayer de remettre en route le service des eaux, et je sais qu’il est le seul, de par ses connaissances, à pouvoir tenter la chose.
Il faut lutter contre l’incendie qui s’étend, veiller à la sécurité et aussi à la salubrité de la ville. A cet égard, il est des besognes particulièrement urgentes. Il faut nettoyer les boucheries et les charcuteries dont les propriétaires sont partis en laissant leurs frigidaires pleins de viande. Or, le courant électrique ne fonctionne plus et, la chaleur aidant, ces charniers intérieurs menacent de constituer des foyers d’infection dans toute la ville. Il faut abattre et enfouir les centaines de chiens et de chats qui, abandonnés par leurs maîtres, errent dans la ville et commencent à devenir dangereux…
Nous nous connaissions assez peu, Vidon et moi ; nous étions éloignés, politiquement. Mais nous ne faisons aujourd’hui aucun effort pour nous comprendre. D’emblée, et sans réserve, il m’assure de sa collaboration absolue.
Celle-ci sera d’une rare qualité au cours des journées qui vont suivre.
20 heures 30.
Visite aux centres d’accueil des réfugiés. Presque tous les locaux sont combles. Mais ceux qui manifestement ont le plus de succès sont ceux qui possèdent des caves ou des abris à proximité.
Les gens ont pu être ravitaillés tant bien que mal. J’ai fait distribuer du lait, des conserves, un peu de pain. Des femmes de bonne volonté assistent les sœurs de Saint-Paul et font la navette entre la Préfecture, la salle Sainte-Foy et les centres pour répartir les vivres. Elles se dépensent, aussi, anonymes et discrètes, auprès des enfants et des vieillards, auprès des malades et des blessés qu’on ne peut plus admettre à l’hôpital, tant il est plein. L’abbé Péchetaux, demeuré à Chartres, se dévoue, de son côté, inlassablement.
A la cathédrale, un spectacle pénible m’attendait : au fond de la plus profonde crypte, éclairée par quelques veilleuses, gît, sur des matelas et des civières, toute une humanité meurtrie. Sur tous les visages, durement sculptés par la pénombre, se lisent l’insomnie, la fièvre, la peur. Les vieux qui n’ont pu suivre, les malades et les blessés qui n’ont pas trouvé place à l’hôpital, tous ceux qui étaient incapables de descendre à tout instant dans les abris ont été transportés là, sans air, sans lumière, sans les commodités les plus élémentaires. Ils sont évidemment à l’abri des bombardements, mais mieux vaut courir le risque d’être atteint par une bombe que de rester dans cette puanteur !…
D’ailleurs, il semble que les bombardements soient moins fréquents et moins violents. Les avions nazis doivent maintenant s’acharner plus loin.
Il est trop tard pour transporter ces pauvres gens ce soir. Mais je veux qu’on les exhume demain à la première heure.
En sortant de là, instinctivement, comme pour chercher une vision apaisante, je me dirige vers les deux boulangeries que nous avons ouvertes et je trouve dans l’arrière-salle mes gens qui attendent la sortie des premiers pains. On ouvre la porte du four pour me permettre de voir l’alignement des miches qui se dorent. Un instant encore et nous goûterons notre pain brûlant, croustillant, du vrai pain de Beauce…
Je me rappelle avoir entendu, dans mon enfance, un vieux paysan raconter que sa mère lui faisait baiser, avant de le manger, le morceau de pain qu’elle lui donnait. Je n’avais pas très bien compris alors… Aujourd’hui, si j’osais, j’embrasserais ce pain blanc qui va nous sauver.
Dans l’autre boulangerie, la fournée est terminée. On m’assure que demain, à l’aube, nous en aurons une autre à chaque four.
Je sors tout heureux, quand le bombardement recommence avec fracas. L’accalmie n’aura pas été de longue durée !
Je décide de réquisitionner une auto, car, si nous avons des blessés, nous ne disposons plus d’aucun véhicule.
Place des Epars, j’ai la chance de mettre la main sur une vieille Berliet transportant deux affectés spéciaux qui se replient. Je m’empresse de me rendre en voiture à l’hôpital, où l’on me confirme que, Dieu merci, on n’a pas signalé de nouveaux blessés.
Les troupes françaises qui se replient sont, entre-temps, arrivées à Chartres. Des camions sont parqués tout le long du boulevard Chasles, entre les deux chaussées. Des artilleurs ont installé leur batterie sous les arbres de la place du Marché aux Bestiaux, en face de l’hôtel du Bœuf Couronné, qui n’en finit pas de brûler.
J’interpelle quelques hommes pour essayer d’accéder jusqu’à l’état-major des unités stationnées à Chartres. Mais je ne peux découvrir qu’un jeune sous-lieutenant qui ne s’y retrouve plus dans la nuit noire et n’arrive pas à me donner d’indications précises.
Je retourne sur la place où mes artilleurs ont sorti tables et bancs. Je m’assieds à côté de ces jeunes soldats et nous nous mettons à bavarder. Ce sont presque des « pays », des gars du Languedoc et du Sud-Ouest. Je leur dis ma satisfaction de voir qu’on va défendre Chartres. Ils hochent la tête avec scepticisme. Et, tout de suite, ils me disent leur surprise de voir qu’on recule sans cesse, sans même attendre le contact avec l’ennemi. Il y a des choses qu’ils n’arrivent pas à comprendre.
Ils ont bon moral, malgré cela, malgré nos défaites, malgré tout. Et je sens qu’il suffirait de peu pour les faire battre avec la rage au ventre, comme il le faudrait dans une lutte qui a un tel enjeu !
L’heure passe et ils me parlent maintenant de chez eux, de leur famille, de tout ce qui les attend après. Après ?
3 heures du matin.
Je vais me coucher, l’ennemi n’arrivera pas cette nuit.
16 juin. 7 heures.
Un violent orage s’est abattu sur la ville cette nuit. La pluie, tombée en abondance, a éteint à peu près complètement l’incendie du quartier de la Poste. Par contre, elle a provoqué un autre sinistre. Une inondation s’est produite à l’intérieur de la chapelle Sainte-Foy où se trouvent de nombreux réfugiés.
Je me rends sur les lieux. Dans la nef de la chapelle, une cinquantaine de lits de camp baignent dans l’eau. Plusieurs vieillards sont encore dans leur couche. Les autres réfugiés sont allés se mettre à l’abri dans la sacristie et les dépendances. Je distribue des vêtements et des couvertures et fais admettre deux des vieillards les plus impotents à l’hospice Saint-Brice.
Avec M. Abdon-Boisson, l’ex-consul qui s’est occupé de l’hôtel du Grand Monarque, j’examine ce nouveau problème qui nous est posé pour l’hébergement des réfugiés, et je décide sur-le-champ de faire ouvrir l’institution Guéry. C’est un vaste établissement scolaire, situé face à la Préfecture, que j’ai déjà utilisé comme centre d’enfants de la région parisienne. Il possède une nombreuse literie, que je peux sensiblement augmenter, et des cuisines pourvues de tout le matériel nécessaire. Nous pourrons regrouper ainsi un nombre important de réfugiés aux abords de la préfecture, ce qui facilitera la surveillance et le ravitaillement. En premier lieu, nous y admettrons les gens de la chapelle Sainte-Foy et ceux de la crypte de la cathédrale.
Je charge M. Boisson de mettre au point l’installation de Guéry, de faire transporter le matériel, de trouver des cuisinières, etc.
Il faut que je mette la main sur l’officier chargé de défendre Chartres. Après plusieurs démarches infructueuses dans la ville, on me signale la présence d’un commandant à Luisant. Je m’y rends à bicyclette, car la Berliet réquisitionnée cette nuit refuse résolument de se remettre en marche.
A Luisant, on me déclare que c’est le commandant de Torquat qu’il faut voir. Il vient d’arriver et a fixé son P.C. à Chartres, boulevard Chasles. Je retourne à Chartres.
Le commandant de Torquat, du 7e régiment de Dragons portés, est installé, avec ses officiers, dans une des maisons qui avoisinent le lycée de filles.
Accueil cordial, mêlé de surprise. C’est, depuis la frontière, le premier préfet qu’il rencontre. Nous parlons de la situation générale. Elle est tragique. Quant à la sienne propre, elle se résume ainsi : son matériel est fatigué et son unité aurait grand besoin d’être reformée ; mais ses hommes sont magnifiques et feront leur devoir jusqu’au bout, quoi qu’il advienne.
Je le questionne sur l’avance allemande dans notre secteur. Il attend justement un agent de liaison qui doit lui apporter des renseignements. Bientôt le motocycliste attendu arrive. J’assiste à son rapport. Les premières unités motorisées allemandes sont aux abords de Nogent-le-Roy, c’est-à-dire à 27 kilomètres.
Je remercie le commandant de Torquat et je prends congé de lui après qu’il m’a demandé de venir partager son déjeuner. J’accepte volontiers.
9 h 30.
Retour à la Préfecture. Minet, le journaliste que j’ai chargé du ravitaillement, me signale que les boulangeries ne rendent pas. On n’a pas fait ce matin de seconde fournée. Nous sommes d’accord pour penser que notre boulanger bénévole est sujet à caution. Je demande qu’on le surveille de près.
En attendant, je voudrais faire parvenir un message à Mécheri, le sous-préfet de Châteaudun, qui pourrait peut-être nous aider.
Rousselot, l’autre journaliste, qui a sa voiture, s’offre pour cette mission. Je rédige aussitôt un mot qu’il emportera. Je donne à Mécheri des nouvelles de notre situation et je lui réclame du pain avec insistance.
Avec la fournée de cette nuit, il nous en reste seulement 300 kilos.
Je vais, toujours à bicyclette, jusqu’aux boulangeries où je secoue sérieusement nos mitrons. J’ai de plus en plus l’impression que notre boulanger fait du mauvais travail et qu’au lieu d’encourager les hommes que j’ai mis à sa disposition, il les détourne de leur devoir, leur offre à boire et cherche mille et un prétextes pour retarder la besogne. Beau parleur, avec cela : « Ce qu’on a pu vous bourrer, mes pauvres agneaux ! Les Boches, c’est des types comme les autres », lance-t-il à tout instant. Décidément, cet individu ne me plaît pas du tout. Seulement, voilà, il est le seul de tous ces gens à savoir faire du pain !
Je l’admoneste vertement, en lui rappelant que c’est la vie de milliers de femmes, d’enfants et de vieillards qui se joue actuellement. Si son attitude ne se modifie pas promptement, je saurai sévir avec toute la brutalité que commandent les circonstances.
Je n’ai pas besoin de continuer. Il a compris. Et se tournant vers ses aides, il leur crie : « Allez, les gars, assez rigolé, au biseness ! »
Dans l’autre boulangerie, personne ! Notre fermière a disparu ; les hommes que je lui avais adjoints l’ont imitée. Le boulanger n’est certainement pas étranger à ce départ.
Je ne m’attarde pas à de vains regrets. On doit pouvoir tirer parti des militaires.
Je file au P.C. du boulevard Chasles pour demander si on n’aurait pas, parmi les hommes disponibles, un ou deux boulangers de métier à me confier. Le capitaine adjoint au commandant me procure immédiatement, pour la journée, deux hommes idoines, que je fais mettre au travail sans délai.
Vraiment, le spectre de la faim est difficile à écarter !
11 heures.
Je reviens à la Préfecture. Les préposés au ravitaillement sont au bureau de bienfaisance que nous avons décidé d’ouvrir pour faciliter les répartitions. Il doit dès aujourd’hui servir un repas à midi.
De nombreuses personnes se présentent à la porte de la Préfecture pour avoir des vivres, du lait condensé, du pain surtout.
Je fais moi-même les distributions. Profitant ensuite d’un instant de répit, je vais m’enfermer dans mon cabinet pour travailler.
Mais bientôt des clameurs m’arrivent de l’extérieur d’où je distingue assez de choses désobligeantes pour que j’accoure aussitôt.
Devant la Préfecture, deux cents personnes environ sont massées, excitées par trois ou quatre énergumènes qui parlent de « mettre le feu à la boîte » et qui souhaitent de voir « arriver vivement les Boches pour mettre de l’ordre dans cette pourriture ». Mon apparition, en tenue, semble faire faiblir un peu les exaltations. Mais bientôt, la foule, manœuvrée par les meneurs, réclame violemment du pain sur l’air des lampions.
Dès que je peux placer un mot, je m’efforce de leur faire entendre raison : « Je fais appel à votre patriotisme, leur dis-je en substance. Je vous demande d’avoir de la tenue et de la dignité à l’approche de l’envahisseur. Au surplus, je comprends votre détresse, mais vous êtes mal venus d’en rendre responsables les seuls qui soient restés pour la soulager. »
Je sens que cela porte, mais j’ai affaire à quelques professionnels de l’émeute qui sont venus exprès pour créer la bagarre. La cinquième colonne donne à plein.
Ils reviennent à la charge et demandent qu’on leur livre des vivres tout de suite.
Je refuse tout net en disant qu’à midi aurait lieu une distribution au bureau de bienfaisance. Seront servis par priorité les vieillards et les enfants, et, en tout dernier lieu, les gaillards qui ont encore la force de crier si haut.
Cette fois, je crois que j’ai gagné la partie. En effet, après quelques récriminations, la foule se disperse. Mais l’incident est significatif.
Midi.
Voici Minet qui revient chercher le pain et les vivres pour le bureau de bienfaisance. Il faut se hâter car la foule commence à arriver.
Nous ne sommes que tous les deux. En prenant la poussette du courrier et en faisant trois ou quatre voyages, nous aurons rapidement fait l’opération. D’autre part, la poussette étant complètement fermée, nous pourrons passer en ville sans attirer l’attention sur son précieux contenu. Nous remplissons prestement notre carriole et dirigeons notre chargement sur le bureau de bienfaisance qui n’est qu’à trois ou quatre cents mètres.
Place de la Cathédrale, attroupement, éclats de voix. Que se passe-t-il?
A l’une des fenêtres du rez-de-chaussée de l’école publique, un homme s’est installé qui harangue la foule. Il a une jambe de bois et fait grand état de sa situation de mutilé de guerre. Avec une violence de langage inouïe, il fait appel à l’émeute, prêche le pillage pour « protester, clame-t-il, contre ceux qui vous ont odieusement bourré le crâne. Il est temps, ajoute-t-il, que les Boches arrivent !… » De nouveau, le grand mot est lâché. Hitler a envoyé de nombreux avocats, mais le plaidoyer est toujours le même !…
Je m’approche et interpelle l’« orateur » pour essayer de le faire taire. Malheureusement, ma tenue – je suis en manches de chemise – n’est pas faite pour en imposer et je ne réussis qu’à déchaîner, de sa part et de celle de plusieurs de ses acolytes, une bordée d’injures à mon adresse. Je bats en retraite en adjurant les auditeurs de ne pas suivre les mauvais bergers.
Je reviendrai à la charge.
Minet, pendant ce temps, est arrivé à destination et a déchargé le pain et les victuailles. Il a trouvé de l’aide et repart chercher un nouveau chargement.
Les locaux du bureau de bienfaisance se prêtent admirablement à des distributions de vivres, et M. Besnard a déjà mis en place un service d’ordre pour faire respecter le sens unique et pour éviter autant que possible les incidents.
Avec le bœuf que Vidon a fait abattre et les monceaux de légumes qu’elles ont épluchés ce matin, les sœurs de Saint-Paul ont préparé un énorme pot-au-feu. J’ai fait apporter de la Préfecture deux mille boîtes de pâté, autant de portions de crème de gruyère et plusieurs caisses de lait condensé. Les corbeilles de pain sont prêtes. On peut enfin commencer la distribution : c’est la meilleure réponse à la cinquième colonne.
12 h 45.
Pendant que la distribution se poursuit sans à-coup, je me hâte vers le P.C. du commandant. Ambiance unique de jeunes officiers qui tous ont fait leurs preuves au feu et que les nouvelles, de plus en plus mauvaises, n’arrivent pas à abattre.
Ici, du moins, les élites n’ont pas failli.
A la fin du repas, le commandant de Torquat prononce quelques mots pour me féliciter de ce qu’il appelle, trop élogieusement, « mon courage civique », et termine en se déclarant fier de me nommer, en présence de ses officiers qui savent toute la valeur qu’il attache à ce titre, Dragon d’honneur du 7e R.D.P.2
Ce n’est pas sans émotion que je le remercie.
J’ai fait part au commandant de mes inquiétudes au sujet des agissements de la cinquième colonne et de mon désir de faire un exemple. « Donnez-moi quelques hommes, lui ai-je dit, pour procéder au moins à l’arrestation de l’agent provocateur de l’école de la cathédrale. »
Huit hommes et un jeune aspirant m’attendent maintenant devant le P.C. pour cette opération. C’est beaucoup plus qu’il n’en faut, mais ce sera une excellente manifestation de force.
Nous nous dirigeons vers la cathédrale. On ne s’entend plus tant sont nombreux les avions qui font du rase-mottes au-dessus de nos têtes. Ils piquent à tour de rôle et, à quarante ou cinquante mètres, lâchent leur rafale de balles. Sur la place des Epars, c’est un véritable carrousel. Ils se succèdent à un rythme effroyable. Des femmes, des enfants fuient en hurlant. Tout autour de la place, des soldats font du plat ventre au pied des maisons.
Nous poursuivons notre route en longeant les murs et bientôt nous arrivons aux abords de l’école. Je pénètre seul et procède, malgré ses protestations et celles de plusieurs individus à mine patibulaire qui l’entourent, à l’arrestation de l’homme à la jambe de bois. Il n’est nullement mutilé de guerre et son amputation est due à un accident du travail. Il porte sur lui un carnet bourré d’indications suspectes et d’adresses qu’il sera intéressant de dépouiller.
Alors que je le livre à mes hommes, une femme, occupée à ranger de la vaisselle, essaie de m’attendrir en me suppliant au nom de ses cinq enfants de ne pas lui arracher son mari. Pressée de questions, elle avoue bien vite qu’elle n’a pas d’enfants et qu’elle n’est pas la femme de notre prisonnier. Celui-ci, ajoute-t-elle, a été envoyé spécialement ici (par qui ? Elle l’ignore ou feint de l’ignorer) pour créer du désordre et ils ont décidé, en arrivant, d’ouvrir un centre d’accueil pour exercer plus d’influence sur les réfugiés. Je décide de l’arrêter à son tour.
Après avoir fait au commandant un rapport écrit, je lui remets ces deux individus pour qu’ils soient livrés à la justice militaire.
L’exemple fut, je crois, fort salutaire, car l’après-midi et la soirée se déroulèrent sans qu’un seul incident vînt troubler la ville.
Nous nous séparons, le commandant et moi, sur une forte poignée de mains. Nous ne devions plus nous revoir. (Le commandant de Torquat a été tué, à quelques kilomètres de Chartres, à la tête de son unité)3.
15 heures.
Un groupe de six ou sept fonctionnaires des P.T.T. de Paris, sous la conduite d’un receveur, se présente à la Préfecture. Ils ont dû abandonner la voiture qui les transportait et viennent prendre des instructions.
Je leur dis tout de suite qu’il n’y a aucun espoir pour eux de continuer leur route, qu’ils s’installent à la Préfecture. Je les occuperai.
Dès qu’ils se seront reposés, ils commenceront à nettoyer les bureaux où mes employés ont séjourné pendant trois jours et trois nuits et qui sont dans le plus grand désordre.
.........................
J’apprends que les boulangeries ont fait enfin de bonnes fournées et qu’un stock assez important a pu être constitué. Le nombre des réfugiés ayant considérablement diminué, je crois maintenant que nous sommes sauvés !
C’est heureux, car aucun secours ne peut nous arriver de l’extérieur. M. Rousselot, qui revient de Châteaudun, où il a crânement rempli sa mission, me fait son compte rendu :
Les bombardements ont été très violents. Il y a des morts et des blessés. L’église de la Madeleine, le Tribunal, la Sous-Préfecture sont en feu. L’hôpital a également été atteint. Les habitants qui restent et les réfugiés ont les pires difficultés à se ravitailler. Le pain manque et le sous-préfet ne peut, malheureusement, rien faire pour nous.
Ces nouvelles m’attristent, mais je suis heureux d’apprendre que Mécheri, malgré l’ordre de repli d’urgence donné l’avant-veille par le gouvernement à la radio, et valable pour tous les affectés spéciaux, est resté, comme je le pensais, à son poste, dirigeant vaillamment les secours.
15 h 30.
Un poilu de la deuxième réserve qui se replie sur son dépôt, et à qui je procure une bicyclette (j’ai un véritable stock de vélos à la Préfecture), m’aide à dépanner une des nombreuses autos abandonnées dans les rues de Chartres. C’est un gros cabriolet Renault qui pourra m’être fort utile.
Je reviens en ville. Place des Epars, les avions continuent leurs mitraillades. C’est maintenant le défilé des tanks qui nous vaut cela.
Deux jeunes des chars qui attendent qu’on les ait dépannés, sont venus bavarder avec moi, au milieu de la place, au pied de la statue : vingt et un et vingt-trois ans. Des Parisiens. Gonflés à bloc. Je pense que Marceau avait cette flamme qui brille dans leurs yeux. Je leur demande leurs impressions : « Que voulez-vous ? On nous fait reculer sans cesse. Depuis quinze jours, nous ne faisons que cela. Et pourtant ! Chaque fois que nous avons contre-attaqué, ça a été dur, mais les Boches ont foutu le camp. »
— Alors ?
— Alors, quand on nous demandera de nous battre une bonne fois, nous tiendrons.
— Et le matériel ?
— Nous en avons peu, certes, mais il est excellent. Ce que nous craignons le plus, ce sont les canons antichars que les Boches nous ont pris.
Ils me quittent pour aller rejoindre leurs camarades. « Vous en faites pas, monsieur le Préfet, me disent-ils, en guise d’adieu, ils ne nous possèdent pas encore. »
17 heures.
Je rentre à la Préfecture. Une des employées des Postes a avec elle sa fille qui est infirmière. C’est providentiel. Je vais l’emmener faire une tournée dans les centres d’accueil pour qu’elle puisse ensuite les visiter régulièrement et apporter ses soins aux malheureux qui s’y trouvent.
Je prends la Renault dépannée. Tournée rapide. Malgré toutes leurs misères, les réfugiés et les Chartrains sont, dans l’ensemble, dans un état sanitaire satisfaisant. Des cas particuliers retiennent cependant notre attention. On nous signale notamment qu’un certain nombre de personnes, surtout des vieillards, n’ont pas quitté les caves depuis jeudi (13 juin).
Je réunis quelques personnes de bonne volonté et nous faisons de la prospection d’abris dans le quartier de la Cathédrale, des Halles, du Marché aux Fleurs. Nous ramenons à la surface plusieurs familles que nous nous efforçons de rassurer. Je demande aux gens de Chartres de rentrer chez eux et de coucher tranquillement dans leur lit. Je fais conduire les réfugiés dans les centres.
Place du Marché aux Fleurs, dans une maison qui comporte trois étages de caves superposées, nous remontons, de quinze mètres sous terre, une vieille femme à peu près complètement paralysée. Elle est là depuis cinq jours !
Je la charge sur ma voiture pour la conduire à l’hospice car son état m’inspire des inquiétudes.
Boulevard de la Courtille, je reste en panne devant un groupe de chars. Un maréchal de logis survient qui m’interpelle : « Qu’est-ce que vous venez faire en avant de nos positions, avec les Boches qui rappliquent ? »
Je suis tête nue, avec mon imperméable qui cache mon uniforme, et bien que je déclare que je suis le préfet et que j’essaie de transporter cette infirme à l’hôpital, il ne me croit pas. « Le préfet ? Non, mais des fois ! La cinquième colonne, plutôt. Je vais appeler le commandant ! »
Survient le commandant qui me demande mes papiers. Quand il a vu ma carte du ministère de l’Intérieur, il s’excuse et se présente : « Commandant Hugo d’Herleville. Nous avons si peu l’habitude, ajoute-t-il, de voir des représentants du pouvoir civil demeurés dans nos lignes que nous nous méfions. » Et aussitôt il met à ma disposition un mécano qui me dépanne.
Enfin je peux déposer mon infirme à l’hospice.
19 heures.
Je rentre me coucher pour quelques heures.
Mes hôtes ont décidé de passer la nuit dans la cave. Mais l’infirmière veut bien m’éveiller à 22 h 30. J’ai, en effet, promis aux jeunes officiers du commandant de Torquat d’aller leur dire bonsoir aux avant-postes, en fin de soirée.
23 h 30.
Je suis à la Porte Guillaume, derrière les chars, avec un jeune lieutenant du 7e R.D.P.
La canonnade qui a roulé à mes oreilles toute la journée semble faiblir. Les Allemands auraient-ils diminué leur pression ? Bientôt nous recevons des nouvelles. C’est, hélas ! l’ordre de repli des troupes françaises.
Minuit.
Tout le monde est embarqué. Je rentre chez moi, solitaire.
Un bruit continu de camions avec, par intervalle, le roulement caractéristique des chenilles des chars d’assaut, viennent me tirer de mon sommeil.
Le bruit persistant, je descends dans le jardin d’où l’on domine le boulevard Sainte-Foy. Dans la nuit, les véhicules lourds et les tanks défilent sans arrêt, venant du nord.
Le cortège se prolonge indéfiniment : amis ou ennemis ?
Je sors et j’essaie de percevoir dans le brouhaha un cri, un commandement qui m’éclaire. Mais rien.
Alors, pour faire cesser ce doute affreux, je crie à ces soldats dont je ne distingue dans l’obscurité que la silhouette imprécise : « Français ou Allemands ? » « Français ! » me répondent plusieurs voix. « Que faites-vous ? » ajoutai-je. « On fout le camp… »
Je reste là dans le noir, tant que dure le défilé. C’est ensuite le passage pénible, poignant de l’infanterie. Ils avancent par groupes, par files, exténués, sans un mot.
Puis les groupes s’espacent. Suivent, traînant la jambe, des isolés. Encore un petit groupe qui s’arrête près de moi, pour reprendre son souffle. Ils sont las, physiquement et moralement. « Que voulez-vous, dit l’un d’eux, qui semble traduire la pensée de tous ses camarades, on nous fait crever à reculer, reculer sans cesse. Nous nous sommes battus et nous étions capables de nous battre encore, nous aussi. Mais on nous épuise dans ces marches forcées, sans ordre, sans but et souvent sans chefs…
« Ah ! si on avait fait une contre-offensive sérieuse, tous les gars auraient fait leur devoir, jusqu’au bout… Mais, maintenant, il est bien tard et je crois bien que tout est foutu… On est crevé !… »
J’essaie de leur remonter le moral, de leur dire qu’ils se referont derrière la Loire et qu’on tiendra… « Puissiez-vous dire vrai », me répondent-ils.
Ce sont les derniers soldats français libres que je devais voir avant de longs mois.
6 heures.
Je suis réveillé par les postiers qui m’annoncent que Mgr Lejards et M. Besnard, que j’ai priés de venir, sont là. Je passe en hâte mon uniforme pour les rejoindre.
Les Allemands pénètrent rarement de nuit dans les villes, mais maintenant ils ne doivent pas tarder à arriver. Rien, désormais, ne les en empêche, sinon quelques Sénégalais qui, dit-on, se sont magnifiquement battus et leur ont fait payer fort cher leur avance.
Nous décidons d’attendre les Allemands dans la cour de la Préfecture. Mgr Lejards à ma droite, Besnard à ma gauche, nous échangeons de tristes réflexions sur les événements. Nous sommes face au drapeau qui flotte toujours au-dessus de la grille d’entrée. Nous nous surprenons à le regarder intensément, comme si nous voulions en emplir, en rassasier nos yeux pour longtemps…
Soudain des moteurs pétaradent. Ce sont les premiers motocyclistes qui passent, non sans regarder avec surprise ces trois personnages, impassibles sous les couleurs françaises.
Il est 7 heures.
Ce sont ensuite des autos-mitrailleuses. Elles ralentissent l’allure devant le spectacle que nous leur offrons, mais ne s’arrêtent pas.
Bientôt, une grosse voiture vient stopper devant nous d’où sortent prestement plusieurs officiers. Saluts militaires.
Le plus âgé, qui est assurément le chef, s’approche et, en français, demande qui nous sommes.
Je déclare que je suis le préfet et que j’ai à mes côtés le représentant de l’évêque et le maire de Chartres.
J’ajoute : « La fortune des armes vous amène en vainqueurs dans notre ville. Nous nous inclinons devant la loi de la guerre, et je puis vous affirmer que l’ordre ne sera point troublé si, de votre côté, vous nous donnez l’assurance que vos troupes respecteront la population civile et spécialement les femmes et les enfants. »
Sur quoi l’officier me répond : « Vous pouvez être sûr que les soldats allemands respecteront la population. Je vous considère, monsieur le Préfet, comme responsable de l’ordre et je vous prie de demeurer ici. Dites à tous vos administrés que la guerre est finie pour eux. »
Ils repartent aussitôt. Mgr Lejards et M. Besnard restent à mes côtés pour arrêter les dernières consignes à la population, en conformité avec mes engagements.
Nous entendons rouler maintenant sans arrêt les blindés ennemis qui doivent occuper la ville et poursuivre leur avance. La petite rue Colin-d’Herleville4 que nous avons sous nos yeux est en dehors des grands itinéraires et nous ne verrons plus que quelques autos isolées et bientôt des officiers et des soldats à pied.
C’est ainsi que nous voyons un officier allemand et un civil qui avancent bras-dessus, bras-dessous, dans notre direction.
Il me semble reconnaître le civil. Je ne me trompe pas : c’est notre boulanger ! Je n’avais pas tort de me méfier…
Maintenant il nous nargue et nous présente son compagnon : « C’est un copain, un chic type. Il voudrait visiter la cathédrale. Il est très amateur, vous savez… »
L’officier, monocle à l’œil, ricane.
Nous demeurons muets. Je sens que, sans nous être concertés, aucun de nous ne répondra à ce vil espion.
L’Allemand a compris et, au bout d’un moment, c’est lui qui demande en français à Mgr Lejards la permission de visiter la cathédrale.
Il accorde l’autorisation et déclare que, d’ailleurs, la cathédrale est toujours ouverte au culte.
La réponse est correcte, mais, dans les yeux du prélat, je lis toute l’humiliation du chrétien et du Français.
La matinée se passe sans incident sérieux. Je reste à la Préfecture et j’assiste à l’enlèvement de mes deux autos, la vieille Berliet et la Renault, par le service de la récupération dont le premier travail est de dépanner ou de remorquer jusqu’aux camions-ateliers tous les véhicules utilisables.
Je fais remarquer qu’il ne s’agit point de matériel de guerre et je proteste contre cette prise de possession arbitraire. Mes observations sont vaines.
10 h 30.
Je profite de la tranquillité relative qui m’est laissée pour visiter les bureaux qui sont à présent impeccables. J’y installe les employés des Postes qui assurent également le service de l’entrée.
J’ai demandé à la mairie d’en faire autant avec tout le personnel bénévole qu’elle aura pu grouper.
Nos réfugiés sont maintenant convenablement hébergés et, de même que les Chartrains, assurés d’être ravitaillés. Les services publics indispensables peuvent fonctionner.
L’envahisseur a ainsi devant lui une organisation sociale avec laquelle il doit compter. Cela aura, en tout cas, l’avantage de nous épargner les centaines d’affiches de propagande dont furent gratifiées certaines villes : « Populations abandonnées, faites confiance au soldat allemand ! »
Ce n’est que quelques jours après, et pour spéculer sur l’abandon dans lequel nous laissait le gouvernement, que quelques-unes de ces affiches firent leur apparition sur les murs de la ville.
14 h 30.
Tournée en ville en civil. Les camions continuent à affluer et se rangent méthodiquement sur les emplacements disponibles. Il y en a boulevard Sainte-Foy, boulevard Chasles, boulevard de la Courtille, sur les bords de l’Eure, place Drouvaire, sur la promenade des Charbonniers. Grande concentration aussi sur le terre-plein de la place des Epars. Motos et voitures légères croisent et dépassent à tout instant les convois lourds.
Des équipes de téléphonistes déroulent des kilomètres de fils qu’ils accrochent aux maisons, aux arbres, aux réverbères…
Après les tanks, il est passé, paraît-il, beaucoup d’artillerie. Maintenant ce sont les fantassins qui défilent, l’arme à la bretelle, tête nue, le casque à la ceinture.
Dans le ciel, quelques avions patrouillent.
Les civils sont rares et hâtent le pas. Je rencontre cependant quelques personnes amies. Nous échangeons les nouvelles que nous avons : Ce matin, à leur arrivée, les Allemands ont crié à tous les civils qu’ils ont rencontrés : « La guerre est finie pour vous ! » C’est la consigne. Je l’ai d’ailleurs reçue moi-même.
Ils répandent maintenant la nouvelle de la capitulation de l’armée française, de la fuite de Reynaud et de Mandel en Angleterre. Lorsqu’ils peuvent approcher un groupe de Français, ils leur font écouter, en allemand, la radio de bord de leur voiture et traduisent ensuite à leur façon. Privés de T.S.F., personne n’a le moyen de contrôler leurs dires.
Mais ce que les Allemands ne disent pas, ce sont les atrocités qu’ils ont déjà commises dans le département.
J’apprends d’un homme sûr qui arrive à bicyclette du nord du département, qu’à Luray, une femme de quatre-vingt-trois ans a été fusillée ce matin pour avoir protesté contre l’occupation de sa maison.
J’aurai, par la suite, l’occasion de vérifier officiellement ce forfait qui a été plus ignoble que je ne pensais. La victime en est Mme veuve Bourgeois, née Paucher, originaire de Luray, où elle était domiciliée.
A l’aube du 17 juin 1940, les Allemands pénètrent par effraction dans sa maison. Mme Bourgeois survient et proteste vigoureusement contre cette violation de domicile. Sur ordre de leur chef, les soldats allemands s’emparent d’elle et l’entraînent dans un jardin. Elle est attachée à un arbre et fusillée sous les yeux et malgré les supplications de sa fille.
Mais là ne s’arrête pas la monstruosité de ces nouveaux barbares. Il faut aux nazis des raffinements : les Allemands interdisent à la fille de Mme Bourgeois de faire enlever le corps de sa mère qui devra rester vingt-quatre heures à l’arbre où elle a été suppliciée. Bien plus, ils obligent la fille à creuser elle-même la tombe de sa mère avec, tout le temps que durera cette douloureuse besogne, son cadavre sous les yeux.
Ainsi, à l’heure même où un officier supérieur allemand me donnait l’assurance que l’armée allemande respecterait la population civile du département, des membres de cette armée allemande commettaient contre une femme de quatre-vingt-trois ans ce crime odieux !
Je vais à la mairie, où je trouve Besnard et Vidon. Ce dernier a déjà pris contact avec les Allemands pour essayer de faire redonner l’eau à la ville. D’accord avec M. Besnard, je demande à Vidon, étant données les difficultés considérables auxquelles nous aurons à nous heurter, et pour renforcer son autorité vis-à-vis de l’occupant, de prendre officiellement le titre de maire de Chartres.
16 h 30.
Je rentre à la Préfecture par la vieille ville. On s’était habitué au silence de ces petites rues où tout était clos. On pensait qu’elles avaient perdu la vie. Et voilà qu’en passant, tout à coup, dans l’entrebâillement d’une porte de bistrot, on entend des voix gutturales, un rire de femme, un bouchon qui saute.
(Je me hâte d’écrire que de quelques actes de veulerie individuelle il faut se garder d’inférer la moindre défaillance collective. Il est de mon devoir de dire ici que la population de Chartres et de l’Eure-et-Loir, dans son immense majorité, a été, au contraire, dès le début, d’une dignité qui, dans de nombreux cas, a atteint le courage, voire l’héroïsme.)
Je constate que le pillage a considérablement augmenté. Il est vrai que les pillards ont reçu un sérieux renfort. Sur mon trajet, plusieurs magasins qui, hier encore, étaient intacts, sont complètement dévalisés. Place du Marché aux Fleurs, je vois un soldat allemand sortir à quatre pattes d’une bijouterie. Ailleurs, c’est par autos entières, quand ce n’est pas par camions, qu’officiers et soldats enlèvent les tissus, les conserves, les bouteilles…
A la Préfecture, mes collaborateurs me confirment qu’il en est de même dans tous les quartiers. Dans beaucoup de cas, d’ailleurs, au lieu d’opérer eux-mêmes, les Allemands utilisent les civils qu’ils ont surpris en train de piller. Au lieu de les punir, ils les prennent sous leur protection, les amènent à pied-d’œuvre devant les boutiques qui les intéressent et leur font briser les devantures. Lorsque les voies sont ouvertes, ils entrent à la suite des civils.
(C’est un exemple caractéristique de l’hypocrisie nazie. Combien de fois, par la suite, ai-je entendu des officiers allemands dire, au sujet de ces vols manifestes contre lesquels je protestais : « Le soldat allemand n’est pas un pillard ; il ne commet jamais une effraction ; mais on ne peut lui demander de ne pas profiter des biens abandonnés qui s’offrent à portée de la main. »)
18 heures.
Je m’assieds pour partager le repas de mes postiers qui ont décidé de dîner de bonne heure, car ils ont hâte d’aller s’enfermer solidement pour la nuit.
A peine ai-je goûté au potage que l’employé qui assure la permanence de l’entrée accourt pour me dire que deux officiers allemands me demandent d’urgence.
Qu’on les fasse patienter un instant, le temps que j’aille revêtir mon uniforme. Je veux, en effet, rester, vis-à-vis de l’ennemi, sur le plan strict des relations officielles.
Je les reçois dans mon cabinet. Celui qui prend la parole, dans le français le plus pur et presque sans accent, est un jeune officier d’environ trente ans. Blond, mince, il est plutôt petit avec, dans le faciès, un mélange inquiétant de morgue et d’obséquiosité.
Il porte, comme son camarade, l’uniforme de la Wehrmacht.
(Je me suis posé, par la suite, la question de savoir si ces hommes, et en particulier ce jeune officier, avaient sur leur uniforme les trois lettres caractéristiques de la Gestapo sur l’épaulette. Je ne saurais le dire. Je n’étais pas encore, à ce moment, familiarisé avec les grades et spécialités de l’armée et de l’organisation nazies.)
«Le général, me dit-il, sur un ton déférent, désire vous voir, monsieur le Préfet, pour une communication importante, et m’a demandé de venir vous chercher.
— C’est bien, répondis-je, je vous suis.
Nous montons dans une voiture qui stationne devant la Préfecture et qui démarre aussitôt. Place des Epars, les officiers me prient de descendre et d’attendre devant l’hôtel de France, qui est occupé depuis le matin. Ils vont, me disent-ils, annoncer mon arrivée au général. Un quart d’heure se passe, vingt minutes. Pour tromper l’attente, je me dispose à faire quelques pas sur le trottoir, quand un soldat, que je n’avais pas remarqué et qui est chargé, apparemment, de veiller sur moi, croise son fusil et m’interdit de bouger. Je n’insiste pas.
Le jeune officier revient d’ailleurs quelques instants après. Il est seul et me demande d’avancer à pied avec lui.
Au milieu de la place, dans le bruit des moteurs et le va-et-vient des militaires de tous grades, il s’arrête et commence à me donner des précisions sur ce que le général attend de moi. Avec une indignation factice, il fait état de prétendues atrocités commises par nos soldats en se retirant : « Des femmes et des enfants, des Français, précise-t-il, ont été massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires qui ont commis ces crimes dont la France portera la honte. Comme ces faits sont prouvés de façon irréfutable, il convenait qu’un document fût dressé qui établît les responsabilités. C’est dans ces conditions que les services de l’armée allemande ont rédigé un “protocole” qui doit être signé par notre général, au nom de l’armée allemande, et par vous comme préfet du département. »
Je manifeste ma stupéfaction et je proteste contre les accusations portées contre l’armée française, et notamment contre les troupes noires : « Nos tirailleurs, ajouté-je, combattent, certes, avec une énergie farouche sur le champ de bataille, mais ils sont incapables de commettre une mauvaise action contre des populations civiles et moins encore les crimes dont vous les accusez. »
Je sens que nous allons nous heurter durement.
«Je regrette, me dit-il d’un ton sec, mais nous sommes absolument certains de ces faits. En tout cas, suivez-moi chez le général.»
J’obéis.
Nous arrivons à l’entrée de la rue du Docteur-Maunoury. On me fait pénétrer dans une vaste et belle maison, un peu en retrait de la rue. Dès que nous franchissons le seuil, deux soldats se précipitent sur leur fusil, mettent baïonnette au canon et m’examinent de la tête aux pieds. Décidément mon arrivée est annoncée. L’officier me laisse entre les mains de ces deux hommes et pénètre dans la première pièce à droite. Il ressort aussitôt et m’invite à entrer à mon tour. Je suis maintenant en présence de trois officiers dont deux sont ceux-là mêmes qui sont venus me chercher à la Préfecture. Le troisième est derrière une table sur laquelle se trouvent des serviettes en cuir et un certain nombre de papiers.
D’une façon beaucoup plus brutale, celui qui m’a conduit ici, et qui semble chargé de mener toute l’affaire, me signifie à nouveau ce qu’on attend de moi : « Voici le protocole que vous devez signer. » Et l’homme qui est assis à la table, sans se lever, me tend une feuille dactylographiée.
« Pensez-vous vraiment, leur dis-je en refusant de prendre le papier, qu’un Français, et, qui plus est, un haut fonctionnaire français, qui a la mission de représenter son pays devant l’ennemi, puisse accepter de signer une pareille infamie ? »
La réaction est immédiate. Le meneur de jeu nazi se précipite sur moi et, rouge de colère, me menace du poing : « Nous n’accepterons pas, me crie-t-il, que vous vous moquiez de l’armée de la Grande Allemagne ! Vous allez signer, m’entendez-vous, vous allez signer ! » Il m’a pris maintenant par le revers de ma vareuse et me secoue furieusement. Je ne me défends pas.
«Ce n’est pas, croyez-moi, répliqué-je, en me brutalisant que vous obtiendrez davantage que je commette une indignité. »
Alors, avec une force peu commune chez un petit bonhomme de cette espèce, il me projette violemment contre la table. Je titube un peu pour rétablir mon équilibre, ce qui déchaîne les rires des trois nazis.
Celui qui était assis tout à l’heure s’est maintenant levé et essaie dans un mauvais français, mais sur un ton plus calme, de me convaincre de l’obligation dans laquelle je suis de signer le « protocole ».
Le nazi. – Nous avons toutes les preuves que ce sont vos soldats qui ont commis ces atrocités.
Moi. – Je veux bien que vous m’indiquiez ces preuves.
Le nazi, prenant la feuille qu’il m’a tendue tout à l’heure. – Aux termes du protocole, des effectifs français et notamment des soldats noirs ont emprunté, dans leur retraite, une voie de chemin de fer près de laquelle ont été trouvés, à 12 kilomètres environ de Chartres, les corps mutilés et violés de plusieurs femmes et enfants.
Moi. – Quelles preuves avez-vous que les tirailleurs sénégalais sont passés exactement à l’endroit où vous avez découvert les cadavres ?
Le nazi. – On a retrouvé du matériel abandonné par eux.
Moi. – Je veux bien le croire. Mais en admettant que des troupes noires soient passées par là, comment arrivez-vous à prouver leur culpabilité ?
Le nazi. – Aucun doute à ce sujet. Les victimes ont été examinées par des spécialistes allemands. Les violences qu’elles ont subies offrent toutes les caractéristiques des crimes commis par des nègres.
Malgré l’objet tragique de cette discussion, je ne peux m’empêcher de sourire : « Les caractéristiques des crimes commis par des nègres. » C’est tout ce qu’ils ont trouvé comme preuves !…
Mon sourire les met en rage et mon interlocuteur m’injurie furieusement en allemand. Alors, le jeune nazi dit quelques mots à voix basse au troisième officier qui est resté immobile et silencieux.
Ce dernier sort son revolver et, se plaçant derrière moi, appuie le canon de son arme dans mon dos.
Il me pousse ensuite brutalement vers la table où, d’un geste autoritaire, une plume m’est tendue pour que je signe.
« Signez, me dit l’officier blond, ou vous saurez ce qu’il en coûte de narguer des officiers allemands. »
Comme je ne me résous pas à me pencher pour prendre la plume, je reçois entre les omoplates un coup qui me fait chanceler. C’est l’officier qui se trouve derrière moi qui m’a frappé violemment avec le canon de son arme.
Je proteste contre ces odieux traitements : « On m’a amené ici pour voir le général. Où est le général ? C’est avec lui que je veux traiter. »
Mon appel au général est accueilli par des rires bruyants accompagnés de plaisanteries en allemand que je n’arrive pas à saisir.
« Il n’est plus question du général, me dit enfin le jeune officier blond, mais nous allons vous conduire à un autre officier », et il appelle un des factionnaires de l’entrée auquel il donne un ordre. Le soldat me saisit par l’épaule et me pousse, plutôt qu’il ne me dirige, vers une autre pièce de la maison. Comme, à son gré, je ne franchis pas assez vite le seuil de cette pièce, il m’assène un tel coup de crosse dans les reins que, cette fois, je m’affale sur le plancher. Avant que j’aie eu le temps de me relever, des coups de botte pleuvent sur moi. C’est l’officier à qui l’on m’a conduit qui vient de me frapper ainsi.
Je me demande si j’aurai la force de me remettre sur pied.
Devant moi, j’ai maintenant l’officier blond qui nous a suivis, l’officier qui m’a reçu à coups de botte, et le soldat, baïonnette au canon.
Le petit officier blond, que j’appelle désormais mon bourreau nº 1, fait un geste au soldat qui pointe sa baïonnette sur ma poitrine en criant en allemand : « Debout ! »
Dans un sursaut douloureux, je me redresse. J’ai terriblement mal. Je sens que mes jambes me portent difficilement. Instinctivement je m’approche d’une chaise pour m’asseoir. Le soldat la retire brutalement et me lance sa crosse sur les pieds. Je ne peux m’empêcher de hurler :
«Quand ces procédés infâmes vont-ils cesser ? dis-je après avoir repris quelque peu mes esprits.
— Pas avant, déclare mon bourreau nº 1, que vous n’ayez signé le “protocole”. Et, à nouveau, il me tend le papier.
Moi. – Je ne comprends pas que vous vous acharniez ainsi et surtout que vous vous abaissiez à de pareilles méthodes. J’ai été soldat, moi aussi, pendant la grande guerre, et j’avais appris à respecter le soldat allemand. Mais la besogne que vous faites en ce moment déshonore votre uniforme.
A ces mots, les deux officiers bondissent sur moi en me criant qu’ils ne se laisseront pas injurier.
L’un d’eux, celui qui m’a frappé lorsque j’étais à terre, un grand brun au corps d’athlète et à la face de brute, m’a saisi à la gorge et me serre à m’étouffer. Sur l’intervention de mon bourreau nº 1, il me lâche enfin.
Pendant que je retrouve péniblement mon souffle, continuent à fuser, à mon adresse, en français et en allemand, de grossières injures.
Ils me traînent maintenant jusqu’à une table où a été placé le « protocole ».
Moi. – Non, je ne signerai pas. Vous savez bien que je ne peux pas apposer ma signature au bas d’un texte qui déshonore l’armée française.
Mon bourreau nº 1. – Mais il n’y a plus d’armée française. Elle est vaincue, lamentablement vaincue. La France s’est écroulée. Son gouvernement a fui. Vous n’êtes plus rien. Tout est fini.
Moi. – Soit, mais il y a une chose qui, pour l’armée française, même vaincue, comptera toujours : c’est son honneur, et ce n’est pas moi qui contribuerai à l’entacher… D’autre part, si, comme vous le dites, je ne représente plus rien, pourquoi tenez-vous tant à ce que je signe votre « protocole » ?
L’Allemand. – Uniquement parce qu’il est conforme à la vérité et pour établir les responsabilités.
Moi. – Mais si vous avez des preuves de ce que vous avancez, personne ne pourra accuser l’armée allemande et ce n’est pas une signature arrachée à un ennemi qui conférera à votre récit un surcroît d’authenticité.
L’Allemand. – Vous n’êtes qu’un raisonneur de Français.
Je sens mes forces me lâcher. Plusieurs fois j’ai failli m’affaisser et chaque fois le soldat m’a frappé de son fusil sur les chevilles et le bout des pieds.
C’est l’autre officier qui maintenant me reprend.
Il m’accuse d’avoir été partisan de cette guerre injuste contre l’Allemagne, d’avoir fait apposer des affiches incitant la population à la résistance.
« J’ai fait mon devoir, dis-je, vous étiez l’ennemi. »
Il me reproche aussi avec emportement d’être resté à Chartres pour provoquer les Allemands.
« Je suis resté parce qu’il était également de mon devoir de ne pas abandonner mes administrés. D’ailleurs, j’en avais reçu l’ordre de mon chef, le ministre de l’Intérieur. »
C’est alors mon bourreau nº 1 qui intervient, dans un état de surexcitation considérable : « Ah ! vous osez parler de votre chef ! Vous osez parler du juif Mandel ! De cet immonde juif qui a voulu déchaîner la guerre contre l’Allemagne ! De ce pourceau de juif vendu aux Anglais ! Avouez, avouez que vous étiez à la solde de ce sale juif… »
Je rectifie : « Pas à la solde, sous les ordres… »
Et il poursuit avec fureur : « Vous êtes un pays dégénéré, un pays de juifs et de nègres… »
Ils se relaient ainsi constamment pour m’épuiser de plus en plus et m’arracher ma signature.
A un moment, le grand officier brun, mon bourreau nº 2, qui a un fox-terrier à ses côtés, se précipite sur moi, au cours de la discussion, et me frappe sauvagement avec la laisse de son chien. Pas un instant ils ne m’ont permis de m’asseoir. Je me demande combien de temps je pourrai tenir…
Nous reparlons de « preuves ». Je ne cesse de dire que leurs preuves ne sont pour moi que des affirmations et ne peuvent me convaincre.
Mon bourreau nº 1 déclare alors : « Ah ! vous voulez vraiment des preuves ! Eh bien, suivez-moi. »
Nous quittons la maison. Dehors, il fait encore grand jour. Le temps m’a pourtant paru bien long !
Une auto est là qui nous attend. Les deux officiers montent devant avec le chien. On me fait asseoir derrière, à côté du soldat. Nous roulons maintenant dans la campagne. Route de Châteaudun d’abord, puis, après avoir obliqué à gauche, route de Saint-Georges-sur-Eure. Pas un civil : les fermes, les champs, tout est désert. Où mes bourreaux me conduisent-ils ? Et quelle lugubre opération complotent-ils ? Je devrais être très inquiet et, pourtant, je me sens presque heureux de pouvoir encore, après les scènes épuisantes de tout à l’heure, respirer l’air des champs et d’être enfin assis ! Les soubresauts de l’auto, qui file à bonne allure, réveillent à tout instant mes douleurs. Mais je suis assis… Je n’aurais jamais cru que de s’asseoir, quand on est si las, provoquerait un tel bien-être.
Nous laissons le village de Saint-Georges à notre gauche et nous nous dirigeons vers le hameau de la Taye. Bientôt, j’aperçois une voie de chemin de fer. C’est bien ce que je pensais. On m’emmène sur les lieux du crime. A moins de cinquante mètres de la voie, la voiture tourne à droite comme pour aller à la petite station de la Taye, et s’arrête devant un vaste immeuble, mi-ferme, mi-café ; c’est le seul bâtiment existant aux abords de la gare.
Nous descendons. Le fox va flairer le corps d’un chien qui gît le long du mur, avec une balle dans la tête.
Mon bourreau nº 1 va directement vers une porte et, sortant de sa poche une clé, nous ouvre le passage. Nous accédons à une banale cour de ferme, encombrée d’instruments agricoles et d’objets ménagers.
L’officier s’approche d’un hangar, à main droite, au fond de la cour, et l’ouvre à deux battants : « Voici, me dit-il, en se tournant vers moi, voici nos preuves. »
Et d’un geste de la main, il montre, alignés côte à côte, neuf pauvres cadavres, tuméfiés, défigurés, informes, dont les vêtements déchirés et maculés permettent à peine de distinguer les sexes. Il y a plusieurs corps d’enfants. Chez deux ou trois des victimes, la convulsion des membres indique une agonie douloureuse.
Dans ce silence de mort, c’est une bien triste vision. Mais, j’en ai tant vu, hélas ! depuis un mois… des paysans tués à côté de leurs chevaux, des réfugiés carbonisés dans leur voiture, des femmes massacrées avec leurs enfants dans les bras… J’en ai tant vu que je n’ai pas grand’peine à maîtriser mon émotion.
Le nazi. – Voilà ce qu’ont fait vos bons nègres. Et il me fait remarquer que ces cadavres sont bien ceux de femmes et d’enfants.
Moi. – Je ne conteste pas ce dernier point.
Le nazi. – Dans ces conditions, j’espère que vous ne ferez plus de difficulté à signer le protocole.
Moi. – De deux choses l’une : ou votre bonne foi a été surprise, ou c’est une effroyable mise en scène. Il ne faut pas être grand clerc pour voir que ces malheureux, dont le corps est criblé d’éclats, sont simplement victimes des bombardements.
Hélas ! j’ai trop parlé, trop bien découvert leur jeu macabre. Alors, avec des regards chargés de tout ce qu’un être humain peut contenir de haine, ils se jettent sur moi et, à plusieurs reprises, leurs poings s’abattent sur ma tête, sur mes épaules, sur ma poitrine.
Le soldat, qui était un peu à l’écart, accourt, la crosse en avant, pour participer à la bagarre, mais on l’arrête d’un geste. Il convient, pour l’instant, de ne pas trop m’abîmer. Un genou et un bras à terre, j’essaie de reprendre des forces qui m’abandonnent de plus en plus. Je me relève enfin pour m’asseoir sur une caisse. On me laisse faire. Sans doute ai-je l’air assez abattu.
Mais bientôt ils s’approchent à nouveau et m’invitent à les suivre jusqu’à une espèce de petit bâtiment bas dont ils ouvrent la porte toute grande.
« Vous voyez, me dit alors mon bourreau nº 1, ceci est le tronc d’une femme dont les membres ont été coupés par les noirs. »
Je vois, en effet, à l’intérieur, étendue sur une sorte de tréteau qui tient à peu près tout le réduit, une chose qui avait dû être un corps de femme, une chose horrible, à moitié nue, avec une chemise que le sang a plaquée par endroits sur la chair, et qui laisse apparaître, dans le bas, deux énormes plaques rondes, où le sang s’est figé, la section des jambes tranchées au haut des cuisses. Plus de bras, non plus. A leur place, deux moignons sanguinolents. Quant à la tête, ce n’est plus qu’une boule informe où le sang a collé les cheveux partout, et qui pend lamentablement.
« Est-ce le bombardement, ricane un de mes bourreaux, qui a si bien tranché ces membres ? » Et, me saisissant par les épaules, il me jette violemment sur le cadavre mutilé. La porte se referme sur moi, vivement.
J’ai été projeté sur ce débris humain et son contact froid et gluant m’a glacé jusqu’aux os.
Dans l’obscurité du réduit, avec cette odeur fade de cadavre qui me prend aux narines, j’ai comme un frisson de fièvre. Alors je sens que je ne pourrai pas résister.
J’essaie d’ouvrir la porte. En vain ! Combien de temps resté-je ainsi, affalé, à attendre qu’on m’arrache à cette présence macabre ? Dix minutes, une demi-heure ? Je ne sais. Mais quand je sors enfin, la nuit commence à tomber.
On ne m’a délivré que pour me présenter le papier, l’ignoble papier. J’ai encore la force de refuser.
Pendant que je me débats ainsi, au milieu de la cour, le grand nazi lève le poing sur moi… Pour éviter ce bras qui va retomber, je m’écarte et cours vers la porte ouverte. Trois coups de feu résonnent coup sur coup à mes oreilles. Je ne suis point touché, mais je m’effondre, incapable de faire un pas de plus. Je n’ai parcouru que quelques mètres. Je n’ai plus la force. Les deux officiers rentrent alors leurs revolvers. Le grand prend la laisse de son chien et, avec l’aide du soldat, m’attache solidement les mains derrière le dos.
On me traîne jusqu’à la voiture où l’on me jette sur la banquette arrière. Le soldat monte à mes côtés. Nous rentrons à Chartres. Pendant le trajet, le soldat saisit la laisse qui me sert de menottes et prend un plaisir sadique à resserrer l’étreinte chaque fois qu’un cahot m’arrache un soupir.
Nous voici de retour place des Epars. La nuit est tombée. La voiture stoppe devant l’Hôtel de France. Un des officiers entre dans l’établissement et revient peu après. Au moment où la voiture démarre, j’aperçois à trois mètres de nous, dans la lueur de la porte de l’hôtel, un civil que je reconnais bien vite. C’est Vidon. Je l’appelle et lui crie que je suis arrêté.
Un vigoureux coup de poing s’abat sur ma mâchoire, suivi de plusieurs coups de crosse dans les jambes. Les officiers pestent après moi.
La voiture fait le tour de la place pour aller se ranger devant la maison où j’ai eu mes premiers contacts avec mes bourreaux.
Les officiers pénètrent dans l’immeuble et me laissent dans l’auto à la garde du soldat.
Au bout d’un quart d’heure environ, on vient me chercher pour m’introduire dans la première pièce de droite. Dans cette pièce, éclairée maintenant par des bougies, je trouve un officier qui n’est pas celui que nous avons laissé tout à l’heure. Il est plus âgé et, sans doute, d’un grade plus élevé. Malgré l’état dans lequel je suis, j’essaie de protester auprès de cet officier contre les traitements dont j’ai été l’objet. J’invoque mon uniforme sali et ma lèvre tuméfiée, ma main gauche en sang…
Il ne veut rien entendre et, dans un mauvais français, se borne à répéter : « Vous devez signer. »
Je ne réponds pas. L’officier sort avec mon bourreau nº 2, laissant avec moi son camarade et le soldat. Sur un signe de son supérieur, le soldat vient délier la laisse qui enserre mes mains.
Mon bourreau nº 1 sort une fois de plus de sa serviette le protocole, l’étale sur la table et me dit : « Pourquoi cette résistance inutile ? Nous savons très bien que nous vous ferons signer… Je vous laisse réfléchir. »
Je ne dis rien. A quoi bon ? Il sort.
Le soldat qui est resté avec moi me fait vite comprendre que je ne dois ni m’asseoir, ni m’éloigner de la table. Il frappe régulièrement le plancher avec la crosse de son fusil pour me rappeler qu’à la moindre défaillance il aura la joie de m’écraser les pieds.
Nous ne disons rien, ni l’un, ni l’autre. De temps en temps, quand nos regards se croisent, il me montre d’un doigt impératif l’odieux « protocole ».
Le temps passe. Je souffre affreusement et je me demande comment j’arrive à tenir encore.
Enfin mes bourreaux reparaissent, jettent un coup d’œil sur la feuille et font signe au soldat de m’emmener.
La voiture est toujours là, tous phares éteints. Nous montons. Où va-t-on encore me transporter ? La voiture fait quatre à cinq cents mètres dans la nuit et, après avoir passé une grille, s’arrête sous un massif d’arbres.
On m’extrait de l’auto et, après quelques pas, on m’introduit dans un immeuble isolé.
Un feldwebel nous accueille, une lanterne à la main. A l’intérieur, une salle assez grande transformée en corps de garde. Des soldats allemands, dont quelques-uns baïonnette au canon. Dans un coin, un nègre, qui doit être un tirailleur sénégalais fait prisonnier. Pieds nus, en manche de chemise, il mange un morceau de pain noir.
Je suis toujours debout, debout depuis des heures, avec des douleurs intolérables, dans les reins surtout. Et mes pieds, mes pauvres pieds, n’arrivent plus à me porter !
Je sens que si bientôt on ne me permet pas de m’asseoir ou de me coucher, je m’effondrerai comme une masse.
Le sous-officier qui semble être le chef de poste vient vers moi, sur un signe de ses chefs, et me fouille du haut en bas. Je n’ai rien dans les poches. D’ailleurs, j’ai fait vite pour me changer et j’ai tout laissé dans mon costume civil.
L’opération terminée, mon bourreau nº 1 se place devant moi et me déclare en martelant tous ses mots : « Ecoutez-moi bien. Je vais vous donner une dernière chance : demain, nous vous ferons signer. Seulement, en signant ce soir, vous vous éviterez quelques ennuis supplémentaires qui vous feront regretter d’avoir tant tardé. »
Il tient le « protocole » dans la main. Je le regarde sans rien dire. Mes yeux doivent être chargés de tant de mépris qu’il n’insiste pas. Il se tourne brusquement vers le feldwebel et lui donne un ordre bref. Le sous-officier fait signe à deux soldats, prend un trousseau de clefs et se dirige vers un couloir étroit en se guidant à l’aide d’une lampe électrique. Les deux soldats me poussent à sa suite et profitent de l’obscurité pour me frapper sauvagement avec leur fusil. Au bout du couloir, le feldwebel ouvre une porte, à gauche, et projette le faisceau lumineux de sa lampe à l’intérieur d’une petite pièce carrée. C’est une salle à manger au mobilier modeste. Les tiroirs du buffet sont ouverts et ont été visiblement fouillés. La table et les chaises sont poussées dans un coin pour faire place à un petit matelas. Sur celui-ci est déjà allongé le Sénégalais qui se trouvait tout à l’heure dans le corps de garde.
Mes deux bourreaux, que j’entends derrière les soldats, ont suivi pour jouir du spectacle. Avec un ricanement, mon bourreau nº 1 me crie : « Comme nous connaissons maintenant votre amour pour les nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l’un d’eux. » Et les soldats, sur injonction de leurs officiers qui continuent à rire bruyamment, me saisissent à bras-le-corps et me jettent violemment sur le malheureux tirailleur qui recule effrayé. Ma tête va heurter le mur. La porte se referme alors.
Malgré le choc que j’ai reçu, je n’ai pas perdu connaissance et je perçois encore derrière la porte, la voix du chef nazi qui donne des instructions sévères aux gardiens pour qu’il soit veillé très attentivement sur nous. A plusieurs reprises il répète, et je m’excuse de citer : « … sehr interessanten Leute, sehr interessanten Leute… »
Dans l’obscurité, le brave Sénégalais m’a cédé sa place sur l’unique matelas et s’est couché un peu plus loin. Je lui passe les couvertures car le sol est rempli de morceaux de verre provenant des vitres brisées pendant le bombardement.
Mais je ne peux prendre aucun repos. Tout à l’heure, le réveil placé sur la table du feldwebel marquait 1 heure du matin. Pendant sept heures j’ai été mis à la torture physiquement et moralement.
Je sais qu’aujourd’hui je suis allé jusqu’à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer.
Le dilemme s’impose de plus en plus : signer ou disparaître…
Fuir ?… C’est impossible. J’entends le pas régulier des sentinelles, non seulement dans le couloir, mais aussi devant notre unique fenêtre.
Et pourtant, je ne peux pas signer. Je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n’a pu être conçue que par des sadiques en délire. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à l’armée française et me déshonorer moi-même.
Tout plutôt que cela, tout, même la mort.
La mort ?… Dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l’ai acceptée. Depuis, je l’ai vue de près bien des fois… Elle ne me fait pas peur.
Il y a quelques jours encore, en me prenant, elle eût fait un vide ici, dans le camp de la résistance.
Maintenant, j’ai rempli ma mission, ou plutôt, je l’aurai remplie jusqu’au bout quand j’aurai empêché nos ennemis de nous déshonorer.
Mon devoir est tout tracé. Les Boches verront qu’un Français aussi est capable de se saborder…
Je sais que le seul être humain qui pourrait encore me demander des comptes, ma mère, qui m’a donné la vie, me pardonnera lorsqu’elle saura que j’ai fait cela pour que des soldats français ne puissent pas être traités de criminels et pour qu’elle n’ait pas, elle, à rougir de son fils.
J’ai déjà compris le parti que je pourrai tirer de ces débris de verre qui jonchent le sol. Je pense qu’ils peuvent trancher une gorge à défaut d’un couteau.
Quand la résolution est prise, il est simple d’exécuter les gestes nécessaires à l’accomplissement de ce que l’on croit être son devoir.
.........................
Le Sénégalais dort profondément, sans se douter du drame qui se joue à moins d’un mètre de lui, et un peu pour lui.
.........................
Cinq heures sonnent à une horloge. J’ai perdu beaucoup de sang. Il a coulé, lent et chaud sur ma poitrine, pour aller se figer en gros caillots sur le matelas… Mais la vie n’a pas fui… Pourvu que tout soit fini quand ils reviendront et qu’ils ne retrouvent plus à ma place qu’une chose inerte, qui ne peut signer !
Mais bientôt des serrures grincent, des pas approchent. Déjà !… Puisqu’il en est ainsi, c’est debout que je les recevrai.
La porte s’ouvre. Ce sont deux soldats, baïonnette au canon, qui nous annoncent en allemand que nous pouvons faire certaine opération matinale. Ils ne se sont aperçus de rien, au premier abord. Puis, tout à coup, je les vois s’agiter, affolés de la vision qu’ils ont eue de cet homme, aux passementeries brillantes, qui les regarde, debout, couvert de sang, un trou béant à la gorge…
Le chef de poste ne doit pas être là, car il serait accouru aux cris des soldats.
On me fait sortir et asseoir. Je me rends compte que je suis dans la cour de l’hôpital civil et que notre prison est le pavillon du concierge.
Un officier allemand, qui doit être un médecin-major, arrive en hâte avec un infirmier. Soins, pansement.
Dès que je sens que je peux un peu parler, je disculpe le tirailleur sénégalais qu’on commençait à soupçonner.
Le docteur, aidé d’un des hommes de garde, me fait traverser les allées qui conduisent à l’hôpital, et me remet aux mains du docteur Foubert, assez impressionné de me voir en pareille posture. Lorsque les Allemands sont partis, je me hâte d’expliquer au docteur Foubert, aussi bien que me le permet mon état, ce qui s’est passé depuis la veille au soir. Bientôt sœur Henriette arrive. Le docteur la met au courant. Je pense, à tort ou à raison, que, puisque par un hasard providentiel mes bourreaux n’ont pas été alertés avant qu’on m’ait conduit ici, une seule chance de salut est que l’affaire s’ébruite rapidement pour qu’ils ne puissent plus l’étouffer à leur manière.
.........................
Je suis maintenant dans une chambre claire, entouré de cornettes blanches. Tout cela n’est-il pas un mauvais rêve ?…
Hélas ! la triste réalité est toute proche !
Je suis couché depuis à peine dix minutes qu’une religieuse vient m’avertir que les Allemands me réclament d’urgence et que sœur Henriette est en train de parlementer en bas, avec un officier.
Bientôt la porte s’ouvre brutalement et c’est mon bourreau nº 1 qui entre pour m’intimer l’ordre de me lever et de le suivre.
L’on me sort du lit, l’on m’habille et, quelques instants après, avec l’aide du docteur Foubert et des sœurs, je suis dehors, face à l’officier.
En présence du docteur Foubert et avec l’hypocrisie la plus perfide, il ose me demander pourquoi j’ai attenté à mes jours : « Vous savez fort bien qu’après les traitements que vous m’avez fait subir, c’était pour moi le seul moyen de ne pas signer votre protocole. » Et me tournant vers le docteur : « Le protocole aux termes duquel je devais certifier que les soldats français avaient violé et massacré des femmes et des enfants… »
Je m’arrête, épuisé.
Maintenant le nazi proteste de sa bonne foi auprès du docteur Foubert, en déclarant que je me suis certainement mépris et qu’il faut oublier ce « malentendu ».
Il se dirige ensuite vers la grille d’entrée pour faire signe à la voiture qui doit nous emmener.
Pendant ce temps, le docteur Foubert me rapporte les propos insensés que l’officier a tenus sur mon compte à sœur Henriette : « Vous ne saviez pas, ma sœur, lui a-t-il déclaré, que votre préfet avait des mœurs spéciales. Il a voulu passer la nuit avec un nègre, et voilà ce qu’il lui est advenu… »
On me hisse dans l’auto qui vient d’arriver et nous allons ainsi place des Epars, à l’Hôtel de France, qui semble être devenu le siège de la kommandantur. On me fait asseoir dans l’entrée, tandis que l’officier est introduit dans un des salons.
J’entends bientôt des éclats de voix qui me font penser qu’une explication orageuse a lieu à mon sujet.
Au bout d’une vingtaine de minutes, mon bourreau ressort en compagnie d’un autre officier qui, après force saluts et claquements de talons, m’annonce qu’on va me reconduire chez moi et que les médecins allemands sont à ma disposition.
C’est mon bourreau qui est chargé de m’accompagner en auto à la Préfecture.
Là, je trouve les employés des Postes qui, pris de panique en me voyant en si piteux état, s’enfuient sur-le-champ.
15 heures.
La mairie de Chartres est requise d’avoir, en l’absence du maire de Saint-Georges-sur-Eure, à inhumer les corps de neuf victimes du bombardement, à la Taye.
C’est M. Rousselot qui est chargé de cette opération. Le dixième corps, celui de la femme mutilée, a disparu. Il n’est plus question d’atrocités.
Ma fièvre est tombée. Je peux commencer à me lever. Je reprends mes rapports administratifs, avec une nouvelle kommandantur.
14 novembre 1940.
Des mois ont passé sans que jamais un officier allemand fasse allusion à ma mésaventure.
Aujourd’hui je suis reçu au siège de la Feld-Kommandantur, dans le grand immeuble des « Travailleurs Français ».
Dès l’entrée, les factionnaires présentent les armes, les officiers saluent à six pas.
Discours du feld-kommandant, le major Ebmeier, traduit par le lieutenant Zeitler, et se terminant par ces mots :
« Je vous félicite de l’énergie avec laquelle vous avez su défendre les intérêts de vos administrés et l’honneur de votre pays. »
1. « Je dois signaler, à ce sujet, qu’avant ces tristes événements, le dévouement sans limite d’un de mes collaborateurs, M. Decote, chef de division faisant fonctions de chef de cabinet, avait permis d’assurer, dans les conditions maxima, le ravitaillement des réfugiés. Rien qu’à la gare de Chartres, M. Decote avait servi plus de 172 000 repas complets. » (Extrait d’un rapport du Préfet au Ministre de l’Intérieur, 12 juillet 1940.)
2. Le titre exact, d’après le colonel de Torquat, était : brigadier d’honneur de son bataillon.
3. Fort heureusement c’est une erreur due à un faux bruit. Le commandant de Torquat, devenu colonel, a commandé le 1er régiment de Dragons portés à Lunéville jusqu’en 1946, date à laquelle ce régiment a été dissous.
4. Cette rue, dont l’entrée a été dégagée, est devenue, le 11 novembre 1945, la place Jean-Moulin.
Cette édition électronique du livre «Premier combat» de Jean Moulin a été réalisée le 12 mars 2013 par les Éditions de Minuit à partir de l'édition papier du même ouvrage dans la collection « Documents »
(ISBN 9782707304049, n° d'édition 5201, n° d'imprimeur 120544, dépôt légal février 2012).
Le format ePub a été préparé par ePagine.
www.epagine.fr
ISBN 9782707326928